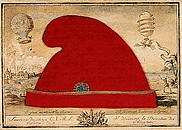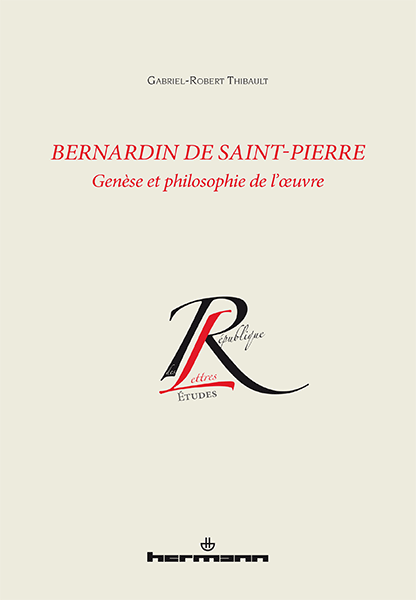Colloque international, organisé par Christophe Miqueu et Jean Mondot les 9, 10 et 11 juin 2016 à l'Université Bordeaux Montaigne, MSHA (salle Jean Borde) et Maison de la Recherche, tramway B Montaigne-Montesquieu. Présentation :
Les recherches sur le républicanisme connaissent en France, depuis quelques années déjà, dans le sillage du renouveau anglo-saxon, un regain d’intensité porté notamment par une perspective souvent pluridisciplinaire.
S’inscrivant dans cette dynamique, ce colloque international se propose d’interroger l’évolution complexe du modèle républicain dans la période où il est souvent présenté comme le plus porteur d’avenir, et où il est exposé en même temps à de nombreuses remises en question : le siècle des Lumières. Les Lumières, trop souvent considérées dans une perspective très franco-centrée, comme une période où le modèle républicain bénéficierait d’une sorte d’unicité conceptuelle, se révèlent bien plutôt comme un moment de profondes mutations, voire de crise de l’idée et des pratiques républicaines. Les Républiques urbaines traversent des crises internes alors que s’engage un débat sur leurs forces et faiblesses comparées aux monarchies éclairées et stables. Les philosophes conçoivent des modèles nouveaux, à l’échelle d’un Etat, s’opposant à la monarchie absolue. La logique traditionnelle du devoir
commence à voir sa primauté discutée par la logique nouvelle du droit. Les voies de l’émancipation privilégient un paradigme de plus en plus pacifique et laissent émerger l’idée républicaine éducatrice et démocratique du citoyen éclairé.
C’est donc le modèle républicain toujours en train de se réformer au plan conceptuel comme au plan empirique que nous proposons d’examiner ici, pour voir en quoi il ouvre sur la modernité. L’espace européen dans son ensemble sera examiné, de même que les Lumières dans leur durée et leur force d’influence.
Lire le programme