La mémoire contre l'événement révolutionnaire Historiographie
par Jacques Guilhaumou, CNRS, UMR Triangle, ENS-LSH Lyon.
A l’occasion du colloque de décembre 1994 sur La France des années 80 au miroir du bicentenaire, tenu à Paris, j’ai dressé un bilan très personnalisé du bicentenaire de la Révolution française. Présentement, je propose ce texte inédit à la lecture, en le maintenant dans son état originel. Je conserve en particulier l’usage de la première personne. En alternance avec ma production scientifique ordinaire, principalement centrée dans le temps du Bicentenaire sur l'histoire des langages de la Révolution française, je suis intervenu plus spécifiquement sur le terrain du discours commémoratif à propos des thèmes suivants: « Faut-il brûler l'historiographie de la Révolution française ? » (1989) (1), « L'historiographie de la Révolution française existe: je ne l'ai pas rencontrée" (1989) (2) », Gestes d'une commémoration: les '36.000 racines de la démocratie locale' » (1992) (3), « La mémoire et l'événement: le 14 juillet 1989 » (1994) (4). Ces interventions, qui vont nourrir tout du long ma réflexion présente, rendent compte d'une prise de distance à l'égard de l'histoire commémorative, soulignée par le contraste entre une activité limitée sur la scène commémorative à une présence discrète, mais continue, au sein des CLEF 89, dont j’ai été l’un des animateurs au plan national, et un fort engagement sur le terrain proprement scientifique par la participation à une cinquantaine de colloques relatifs à la Révolution française, entre 1985 et 1993.
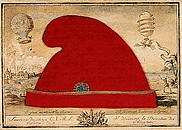
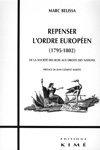 1989… Quand le Mur de Berlin s’écroule, la plupart des commentateurs ne résistent pas à l’analogie avec la prise de la Bastille. Quasi instantanément, l’idée qu’une période historique vient de s’achever s’impose comme une évidence. Le Mur qui tombe, c’est la matérialisation physique, voire esthétique, de la fin d’un ordre européen et mondial — celui de Yalta et de Potsdam — qui s’effondre avec la réunification de l’Allemagne. Tout le monde comprend alors que le système international entre dans une phase de redéfinition, de réorganisation transitoire. Depuis, l’idée d’ordre international ou de "nouvel ordre global" est au centre de tous les débats sur l’avenir de la planète. La mondialisation économique, la fin de l’ordre bipolaire de la guerre froide et les difficultés de la reconstruction d’un ordre juridique international font tous les jours l’actualité. Les conflits dans l’ex-Yougoslavie, puis en Afghanistan et au Proche-Orient, la montée de l’unilatéralisme américain, l’effacement de l’ONU, tous ces événements et ces tendances provoquent une interrogation générale sur la nature des relations entre les États, les peuples, les puissances et sur la possibilité d’ordonner juridiquement le désordre des nations. La construction européenne semble s’emballer et échapper en partie aux peuples qui composent l’Europe réelle. Les débats actuels sur l’édification institutionnelle et politique de l’Union européenne contribuent également à mettre au centre du débat contemporain la question de la définition historique de l’ordre européen. Nous avons le sentiment de vivre un moment particulier de l’histoire de l’humanité dans lequel les modèles de l’État-nation et de la souveraineté étatique traversent des mutations décisives. Un sentiment d’urgence émerge de ce débat. On pressent que les réponses théoriques et pratiques aux défis actuels vont déterminer l’avenir de la planète pour toute une période. Comment penser l’ordre international ? Comment le concevoir ? Comment le construire ? Le nouvel ordre mondial est-il déjà en place ou vivons-nous une période de transition dans laquelle on en entrevoit seulement les éléments principaux ? (1)
1989… Quand le Mur de Berlin s’écroule, la plupart des commentateurs ne résistent pas à l’analogie avec la prise de la Bastille. Quasi instantanément, l’idée qu’une période historique vient de s’achever s’impose comme une évidence. Le Mur qui tombe, c’est la matérialisation physique, voire esthétique, de la fin d’un ordre européen et mondial — celui de Yalta et de Potsdam — qui s’effondre avec la réunification de l’Allemagne. Tout le monde comprend alors que le système international entre dans une phase de redéfinition, de réorganisation transitoire. Depuis, l’idée d’ordre international ou de "nouvel ordre global" est au centre de tous les débats sur l’avenir de la planète. La mondialisation économique, la fin de l’ordre bipolaire de la guerre froide et les difficultés de la reconstruction d’un ordre juridique international font tous les jours l’actualité. Les conflits dans l’ex-Yougoslavie, puis en Afghanistan et au Proche-Orient, la montée de l’unilatéralisme américain, l’effacement de l’ONU, tous ces événements et ces tendances provoquent une interrogation générale sur la nature des relations entre les États, les peuples, les puissances et sur la possibilité d’ordonner juridiquement le désordre des nations. La construction européenne semble s’emballer et échapper en partie aux peuples qui composent l’Europe réelle. Les débats actuels sur l’édification institutionnelle et politique de l’Union européenne contribuent également à mettre au centre du débat contemporain la question de la définition historique de l’ordre européen. Nous avons le sentiment de vivre un moment particulier de l’histoire de l’humanité dans lequel les modèles de l’État-nation et de la souveraineté étatique traversent des mutations décisives. Un sentiment d’urgence émerge de ce débat. On pressent que les réponses théoriques et pratiques aux défis actuels vont déterminer l’avenir de la planète pour toute une période. Comment penser l’ordre international ? Comment le concevoir ? Comment le construire ? Le nouvel ordre mondial est-il déjà en place ou vivons-nous une période de transition dans laquelle on en entrevoit seulement les éléments principaux ? (1)