Le Sens Commun. Histoire d'une idée politique Annonces
samedi 5 avril 2014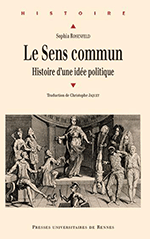
Introduction de l'ouvrage de Sophia Rosenfeld, Le Sens Commun. Histoire d'une idée politique, Rennes, PUR, 2013. Il s'agit de la traduction de Common Sense. A Political History dont Jacques Guilhaumou avait rendu compte sur notre site lors de sa parution originale en 2011.
« Ce qui est familier n’est pas pour cela connu. »
G.W.F. Hegel, Phénoménologie de l’esprit
Ce qui est chaud peut brûler. Deux plus deux font quatre. Voir, c’est croire. Le bleu n’est pas le noir. Chassez le naturel, il revient au galop. Si j’écris ces mots, j’existe.
Il y a bien des raisons de ne pas écrire un livre sur le sens commun, surtout s’il se trouve que l’on est historien. Le sens commun, par définition, est d’abord imperméable à l’histoire. Dans son acception courante, le sens commun est l’expression que nous utilisons parfois pour parler de la faculté humaine fondamentale qui permet de formuler des jugements élémentaires sur des questions quotidiennes, fondées sur notre expérience du monde réel (par exemple, si vous vous servez de votre bon sens, vous devriez comprendre les principes affirmés plus haut !). Mais nous définissons aussi le sens commun comme les conclusions largement partagées et apparemment évidentes tirées de cette faculté, les truismes auxquels toute personne sensée acquiesce sans débat et même sans discussion, dont les principes relatifs aux quantités, aux différences et aux notions de prudence, de cause et d’effet. Quoi qu’il en soit, le sens commun est censé définir ce qui appartient en propre et en commun à tous les humains, où que ce soit dans le temps et dans l’espace (1).
Pour compliquer encore les choses, les principes du sens commun sont apparemment si banals, ils vont tellement de soi, qu’il n’est généralement pas besoin de les dire. Et quand, en de rares occasions, ils sont brandis en tant que tels, explicitement, ce n’est, en général, que pour s’opposer à des atteintes supposées au sens commun. Le reste du temps, tout locuteur ou locutrice se sent obligé d’employer un « bien sûr » préalable comme s’il voulait montrer qu’il ou elle affirme une évidence et énonce un cliché, pour ne pas traiter son interlocuteur d’enfant ou de fou. Sinon, ces présupposés sont tout simplement inhérents aux mots ordinaires que nous utilisons ; ils forment l’arrière-plan tacite de nos activités et de nos pensées les plus conscientes, ils nous soutiennent dans la vie de tous les jours (2). Pour l’historien, il ne saurait y avoir de sujet plus stérile.
Par ailleurs, quand l’historien s’intéresse au sens commun, il le fait en général à partir d’une position d’hostilité ; en sciences humaines, travailler à l’encontre du sens commun est un devoir professionnel (3). Certains philosophes passent parfois leurs journées à s’interroger sur sa validité épistémologique. Mais ceux qui étudient le passé ne s’intéressent au sens commun que dans le but de saper l’autorité de ce qui est considéré aujourd’hui comme tel, dans la société où ils vivent et où ils travaillent. Pensez-vous qu’une famille composée de deux parents de sexe opposé et de leurs enfants relève du sens commun ? Parce qu’ils regardent en arrière comme les anthropologues fouillent des lieux étrangers, les historiens sont capables de montrer que ce n’est pas quelque chose d’inévitable ou de naturel, mais seulement une culture que la familiarité et l’endoctrinement font à tort passer pour le sens commun. C’est ce qu’ont retenu plusieurs générations de lecteurs du remarquable essai de Clifford Geertz, « Common Sense as a Cultural System » (4). Il y a cependant une bonne raison pour laquelle les historiens pourraient avoir envie de s’arrêter et de réfléchir sur l’histoire du sens commun, et sur l’évolution de son contenu, de ses significations, de ses usages et de ses effets. Cette raison, c’est la place centrale que l’idée même de sens commun occupe dans la vie politique moderne et, en particulier, dans la démocratie.
Considérons un instant l’affirmation de Thomas Paine, au XVIIIe siècle, selon laquelle le sens commun est résolument du côté des peuples, et donc l’adversaire des rois. Il n’y a pas de raison, même aujourd’hui, de voir dans ce lien entre sens commun et gouvernement républicain autre chose qu’un argument rhétorique de Paine – ou une manière de prendre ses désirs pour des réalités. Car le plus souvent, dans l’histoire, y compris au début de l’année 1776 en Amérique du Nord, c’est le contraire qui est vrai : le gouvernement du peuple a toujours été considéré comme le meilleur ingrédient du désordre, de l’instabilité ou pire encore. Il vaut la peine de noter, cependant, que même depuis la publication, en cette année fatidique, du Sens commun, le fameux appel aux armes de Paine, les Américains en particulier, mais aussi, et partout, les partisans de la démocratie n’ont prêté qu’un intérêt de pure forme à la valeur épistémologique du jugement collectif, quotidien et instinctif des gens ordinaires. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la vie publique. Non seulement la supériorité du grand nombre sur le petit est devenue une de ces affirmations élémentaires et incontestables dont on peut dire, dans le sillage du philosophe politique John Rawls, qu’elle constitue désormais le « sens commun démocratique (5) » ; mais la confiance dans le sens commun – c’est-à-dire à la fois la faculté partagée de discernement et les quelques principes fondamentaux et inviolables qui sont connus et acceptés de tous – est elle-même devenue un lieu commun. Et la politique a été redéfinie (malgré la complexité croissante du monde où nous vivons) comme le domaine des affirmations simples et quotidiennes, des préceptes moraux élémentaires et des vérités qui devraient être, pour tous, évidentes. Quelques philosophes politiques modernes, parmi lesquels Hannah Arendt, sont même allés plus loin dans l’examen de ce lien pour affirmer que le sens commun est la sève même de la démocratie. Depuis les plus de deux cents ans qui nous séparent de la sortie du petit pamphlet de Paine d’une imprimerie de Philadelphie, l’idée de sens commun a bien des fois suscité la participation des citoyens ordinaires, c’est-à-dire de citoyens n’ayant ni savoir ni expertise spécialisés, à l’élaboration du jugement politique. En retour, propose Arendt, le sens commun produit par des gens ordinaires engagés dans une discussion et un débat sans entrave devrait être considéré comme le terrain commun sur lequel il est possible de bâtir une vie politique riche et collective – ou encore la démocratie réelle (6). Pour Arendt, qui écrivait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais dont la pensée était pénétrée de la période révolutionnaire, la démocratie était largement le résultat d’habitudes de penser. Le sens commun était pour elle à la fois le fondement et le but de tout régime démocratique achevé.
Arendt nous ramène ainsi à une question historique élémentaire, encore qu’elle doive être posée à la lumière du temps présent : comment cela est-il arrivé ? Comment – et avec quelles conséquences durables – le sens commun a-t-il noué cette relation particulière qu’il entretient, à l’époque moderne, avec cette forme de gouvernement populaire que nous appelons démocratie ?
Pour répondre à cette question, il nous faut, au moins pour commencer, revenir en arrière, bien avant l’époque de Thomas Paine. Car les présupposés élémentaires qui ont pris collectivement le nom de sens commun et l’idée même de sens commun (ou, pour tenir compte de quelques variations conceptuelles et proposer quelques traductions, le bon sens, la raison commune, sensus communis, common sense, il senso comune, il buon senso, gemeiner Verstand et gesunder Menschenverstand – entre autres) ont une histoire longue et complexe, même si leur définition semble dire le contraire. C’est une histoire qui, à l’époque moderne, s’étend de part et d’autre du monde de l’Atlantique nord. Et qui est étroitement liée à l’apparition de nouvelles conceptions de la souveraineté populaire entre la Glorieuse Révolution, dans l’Angleterre de la fin du XVIIe siècle, et la Révolution française, à la fin du siècle suivant, période appelée parfois, en écho à Paine, l’« ère des révolutions (7) ».
Au cours de cette centaine d’années, l’appel à l’« oracle » du sens commun est devenu, comme le déplorait Emmanuel Kant moins de dix ans après la première publication du célèbre pamphlet de Paine, « une des subtiles inventions des temps nouveaux ; elle permet au plus fade bavard d’attaquer hardiment l’esprit le plus solide et de lui tenir tête (8) ». Ce que ne dit pas Kant, c’est que l’histoire de la transformation d’un terme technique issu de la science aristotélicienne en trope rhétorique de la démocratisation, ou en moyen de légitimer l’expression d’une opinion non experte dans l’espace public, a elle-même été rendue possible par toute une série d’évolutions antérieures. Et qu’elle a produit des effets extraordinaires.
Au XVIIe siècle, pour des raisons que nous examinerons bientôt, l’idée s’est peu à peu affirmée en Europe du Nord que certaines notions élémentaires et largement incontestées étaient communes (au sens de partagées ou tenues conjointement) aux gens du commun (au sens d’ordinaire) simplement du fait de la nature de ces derniers et de leurs expériences communes (partagées). Cela comprenait l’observation du monde autour d’eux et les communications entre eux (9). De surcroît, bien qu’aucune formation formelle préalable ne fût nécessaire pour arriver à ces jugements élémentaires et universels, et qu’il fût impossible d’en faire la démonstration en vertu de critères scientifiques, ils n’en offraient pas moins un niveau inhabituellement élevé de certitude ou de valeur-vérité. Ils bénéficiaient d’une plausibilité maximale sans le secours d’aucune preuve supplémentaire ni même d’une discussion. Le sens commun était donc prêt, au début du XVIIIe siècle, à faire l’objet d’une revalorisation en tant que nouvelle « autorité épistémique », et même à rivaliser avec des formes bien plus établies d’autorité, parmi lesquelles l’histoire, la loi, la coutume, la foi, la logique et la raison, en particulier sur les questions touchant la vie sociale ou la morale (10). Ce processus (au grand dépit de Kant) a d’abord vu le jour dans la philosophie, quand le lecteur a été encouragé à se joindre à une alliance nouvelle contre le complot qui avait permis à des penseurs du passé faisant autorité d’imposer leurs idées fausses et fantaisistes sur le monde. (Songeons au grand philosophe anglais George Berkeley se rangeant notoirement, au tout début du XVIIIe siècle, aux côtés de la foule.) Le même appel a gagné peu après la sphère politique. Ici, le sens commun servit de fondement à une remise en cause de l’ordre politique existant, en termes de personnel aussi bien que d’idées. Il conduisit aussi à une reformulation du domaine appelé « politique ». En effet, dans le cadre des profondes remises en cause des notions traditionnelles de représentation et de régulation, cette nouvelle manière de penser la pensée cessa d’être une simple idée circulant parmi beaucoup d’autres pour se voir englober dans le domaine que nous appelons encore le « sens commun ».
C’est une histoire encore peu connue. D’après le classique récit libéral, le triomphe de la « Raison », né de la Réforme puis de la révolution scientifique, et fortement alimenté tout au long du XVIIIe siècle, a joué un rôle crucial dans l’invention de l’individu porteur de droits modernes et du constitutionnalisme libéral sur lequel la démocratie politique devait finalement être bâtie. Création de ce que l’on a appelé de manière posthume le « Siècle des lumières » lui-même, cette explication a duré jusqu’à nous en agrégeant dans son sillage de nouveaux éléments (la théorie du droit naturel, les idées de résistance en vue de la souveraineté, enfin l’essor du capitalisme, de l’empire et d’une classe moyenne nouvelle, éduquée et désireuse de voir ses besoins traduits en « opinion publique »). Les postmodernistes eux-mêmes racontent cette histoire : ils se sont contentés d’en changer la morale, faisant de l’individu doté de la raison instrumentale la source non des triomphes mais des plus sombres tragédies du XXe siècle.
Or la démocratie qui est apparue à la fin du XVIIIe siècle, et qui existe encore à ce jour, est un curieux mélange d’interprétation littérale de la vieille idée de souveraineté populaire, ou gouvernement « du peuple », de gouvernement représentatif et de constitutionnalisme. Le concept de sens commun collectif, tantôt allié et tantôt opposé à l’idée d’individu rationnel, a joué un rôle crucial, quoique souvent tacite, dans la construction du visage populaire – par opposition à constitutionnel – de la démocratie. À cet égard, le sens commun ressemble beaucoup à la sympathie et au sentiment naturel, ces catégories affectives inventées au XVIIIe siècle et aujourd’hui très discutées, qui ont aussi été considérées, à l’ère des révolutions, comme des sources importantes du lien social et de la vérité produite collectivement. On pourrait même être tenté de penser le rôle du sens commun en termes de communauté, surtout si l’on tient compte de l’importance accordée à la cohésion sociale, qui relie les deux. Mais ce qu’a permis le concept de sens commun sous sa forme moderne, c’est moins une vision particulière de la façon dont l’ordre politique devrait être constitué, qu’un nouveau style et une nouvelle conception de la politique. L’idée de sens commun a fourni un fondement épistémologique et une justification au « populisme », qui est un des piliers de la démocratie (si l’on souscrit à la vision d’Arendt), mais aussi une de ses principales et constantes menaces (11).
Quelle est la définition du populisme ? Les théoriciens politiques ne s’accordent pas sur ce point. Ils le conçoivent le plus souvent comme une forme de persuasion, présente dans l’ensemble du spectre politique moderne, qui repose sur un appel au nom de tous ceux qui se sentent exclus du processus politique afin qu’ils puissent jouer un rôle public plus actif (12). Il s’agit là généralement de la masse des gens ordinaires (le « peuple » illusoire, la « majorité silencieuse » (13)) qui croit que ceux qui gouvernent ne représentent pas et ne peuvent pas représenter ses intérêts. Cette position s’appuie sur un argument que l’on peut qualifier d’historique ou même de nostalgique, à savoir l’idée que « le peuple » a été récemment privé d’un pouvoir dont il jouissait auparavant librement et à bon droit. Mais il y a aussi un argument épistémologique, au sens où il repose sur une certaine conception des facultés cognitives et morales de l’être humain. Cet argument dit généralement que « le peuple », quand il n’est pas égaré par de fausses autorités, possède une sorte de sens instinctif et infaillible du bien et du vrai, un sens né ou nourri de l’expérience quotidienne du monde, et qui l’emporte nécessairement sur le jugement des « experts » et le savoir d’une petite élite. Cette catégorie – les colporteurs d’un non-sens dangereux – s’est élargie pour englober aujourd’hui, selon les cas, les intellectuels, les scientifiques, les financiers, les avocats, les journalistes, les hommes d’influence, les politiciens et autres prétendants surdiplômés à l’élite, ainsi que les étrangers et les marginaux culturels de toutes sortes. Mais l’idée reste la même. Non seulement les gens ordinaires (pris comme agrégat) savent mieux que tous ces gens-là de quoi il retourne, mais la politique elle-même serait plus simple, plus transparente et surtout moins conflictuelle si l’on se débarrassait des spéculations complexes et du jargon obscur associés à cette classe politique exclusiviste, et si les vrais gens étaient enfin en mesure de voir et de dire les choses telles qu’elles sont.
Sous ses formes les plus connues, le populisme est un style de politique qui s’enracine dans le XIXe siècle, en particulier dans le centre et le sud des États-Unis. Michael Kazin, par exemple, tout en soulignant la vivacité de l’idiome populiste dans l’histoire des États-Unis, ouvre son astucieux et savant Populist Persuasion: An American History sur l’apparition, dans les années 1890, du « Parti du peuple », bel oxymore s’il en est (14). Une des idées que je défends ici, c’est qu’un siècle au moins avant qu’il ne soit qualifié de populiste, ce mode de persuasion direct, coléreux et farouchement « populaire » était déjà en train de prendre forme autour de l’idée abstraite de sens commun. C’est ce qu’on observe dans de multiples avant-postes des Lumières, chez des radicaux aussi bien que chez des conservateurs, et avec des effets variables mais durables sur la pratique de la politique démocratique.
Au XVIIIe siècle, la foi dans l’intuition collective et quotidienne du « peuple » (et pas seulement dans la capacité rationnelle de l’individu) est apparue en même temps que l’idée de gouvernement direct. En 1776, à Philadelphie, le sens commun a étayé les premières expériences modernes de participation populaire à la « gouvernance ». Il est resté un élément central de notre crédo démocratique. Mais c’est précisément parce que le gouvernement du peuple est une notion si vague et si difficile par moments à réconcilier – aux États-Unis comme ailleurs – avec le visage constitutionnel de la démocratie que le sens commun est devenu avec le temps à la fois une forme de fondement de celle-ci et l’ennemi de ses mutations modernes. Ses autres racines plongent dans la Contre-révolution internationale provoquée par ce qui s’est passé en France à partir de 1789. Depuis lors, le sens commun a également servi à justifier, au nom de l’intuition particulière dont le peuple serait doué, une remise en cause des formes établies et légitimes de gouvernement, dont les démocraties. Ce livre porte donc sur un sujet des plus glissants : le mariage long et compliqué entre l’appel populiste (et largement considéré aujourd’hui comme allant de soi) au sens commun du peuple et la forme politique que nous appelons démocratie.
Méthodologiquement, le défi est ici des plus embarrassants. Est-il possible d’écrire l’histoire intellectuelle d’une construction fondamentalement anti-intellectuelle, qui suppose toute une série de présupposés pré-rationnels et tacites ? Sans doute pourrons-nous trouver quelque secours dans l’histoire des concepts, ou Begriffsgeschichte, cette branche de l’histoire intellectuelle qui retrace les sources et l’évolution des appareils mentaux et linguistiques servant à classer et catégoriser nos pensées (15). La mise au jour de distinctions disparues, de connexions oubliées, d’usages contestés ou peu familiers de termes abstraits, par des gens ordinaires ou par des philosophes, peut nous aider en effet à rendre compte des racines de l’innovation politique passée. Elle peut aussi nous permettre de mieux réfléchir sur les limites du vocabulaire politique contemporain et d’examiner comment ces mêmes concepts pourraient être utilisés dans le futur. C’est pourquoi nous commencerons par rappeler quelle était la conception de ce que nous appelons le sens commun chez les Grecs et chez les Romains de l’Antiquité, en restant attentif à la fois à ce qui a changé et à ce qui est resté de ces anciennes significations, notamment dans le domaine de la métaphore. Mais il nous faut aussi, pour mener à bien notre entreprise, demander l’aide de l’histoire sociale des idées (la branche de l’histoire qui étudie le contexte social dans lequel les idées prennent racine), de l’histoire sociale du savoir (qui s’intéresse à l’évolution des structures dans lesquelles ce qui est considéré comme un savoir est produit, diffusé, adapté à de nouveaux usages) et de l’histoire de ce que les historiens français appellent les usages communs, c’est-à-dire l’évolution passée des perceptions, des croyances et des pratiques sociales quotidiennes des différents corps sociaux (16). Après tout, les concepts eux-mêmes prennent forme et acquièrent de l’autorité aussi bien dans les textes que dans la vie sociale. Notre ambition est enfin d’explorer la relation entre, d’un côté, l’évolution du type même de concept – le sens commun – dont l’histoire intellectuelle fait son miel et, de l’autre, l’histoire d’un ensemble de croyances qui, malgré leur importance pour la religion, l’éthique, la politique et la vie quotidienne, sont rarement examinées ou même seulement évoquées – précisément parce que l’histoire les a reléguées dans cette même rubrique naturalisante. Il s’agit donc d’un livre sur la construction discursive du social (dans la mesure où le sens commun est un domaine commun imaginaire, directement issu d’interactions quotidiennes avec le monde et avec ses habitants, et orienté tout spécialement vers la vie sociale). Cet ouvrage est aussi conçu comme une histoire de la construction sociale du discours et comme une histoire de la construction discursive d’une catégorie sociale.
La solution utilisée ici est donc très proche de ce que les historiens de la science appellent l’« épistémologie historique ». Cette méthode implique, en particulier, de montrer quels sont les concepts organisateurs, supposés intemporels, de la science moderne et de la production du savoir – des catégories comme la vérité ou l’objectivité – non seulement en tant que constructions historiques, mais aussi comme produits de pratiques et de valeurs qui semblent très éloignées aujourd’hui du domaine appelé « science ». Cela comprend les critères de beauté, les mœurs et la morale, la concurrence économique, la recherche d’un statut social, les pressions institutionnelles, les normes sexuelles, ainsi que les genres, les discours et les disciplines (17). Mais l’objet de notre étude est finalement au carrefour de ce qui a longtemps été considéré comme ce qu’il y a de plus immuable et de plus invisible dans le récit historique – le sens commun comme mode de connaissance – et de ce qui semble l’être le moins : la vie politique (18). Or il s’avère que les fondements épistémologiques, émotionnels et probatoires de la politique ne sont pas toujours en accord avec ceux des sciences naturelles, des sciences physiques, voire des sciences sociales. Même si la science nouvelle et le sens commun ont été, pendant la quasi-totalité du XVIIIe siècle, de proches alliés, et qu’ils ont eu un ancrage commun dans l’importance accordée par le protestantisme au savoir expérimental et direct, à la simplicité et à la valeur de la « vie ordinaire », leurs partisans ont fini par se séparer, produisant un schisme dont les effets se font encore sentir aujourd’hui (19). La science est devenue le domaine de spécialistes pour qui la simple expérience, en l’absence d’expérimentation contrôlée s’appuyant sur une formation technique, n’est pas une base suffisante pour arriver à des vérités (20). La pensée politique, elle, a pris une autre direction. Et c’est en montrant comment un éthos anti-expertise s’est attaché avec le temps au champ politique qu’une histoire culturelle et intellectuelle du populisme devient enfin possible.
Ce livre s’inscrit dans le cadre de trois grandes évolutions historiques qui ont touché, de façon diverse, les hémisphères septentrional et occidental de la planète. Et comme il convient à une étude de ce que les anciens Grecs appelaient l’endoxique, ou le savoir ordinaire et commun au plus grand nombre (21), elles vont nous aider à mettre en lumière les formidables paradoxes qui traversent l’histoire du sens commun et donc du populisme en tant que forme politique fondée sur cette autorité imaginaire.
La première de ces trois grandes évolutions, c’est l’essor formidable des villes, pour la plupart regroupées en bordure de l’Atlantique nord ou reliées, d’une manière ou d’une autre, au commerce transatlantique. Londres, Paris, Aberdeen, Philadelphie, Édimbourg, Amsterdam, Genève, La Haye : tous ces centres urbains doivent être considérés comme des lieux de savoir locaux, marqués par une grande diversité de mœurs, de cultures religieuses, de régimes juridiques, de systèmes politiques, d’entreprises, d’institutions, de formations de classes, de langues et d’espaces publics – des universités aux imprimeries en passant par les tavernes et les cafés – dans lesquels des idées ont pu prendre forme. Ils ont aussi été, à des degrés divers selon leur taille et leur emplacement, des lieux de mouvement, d’échange, d’emprunt, d’appropriation et de diffusion. Les premières villes modernes, des deux côtés de la Manche et de l’Atlantique, ont entretenu une relation symbiotique avec des villes plus petites et les campagnes environnantes, dont elles dépendaient pour leur main-d’œuvre et pour leur approvisionnement. Elles ont aussi fonctionné dans un espace de plus en plus international. Ces villes dont la fortune, au XVIIIe siècle, était liée à l’Atlantique ont été des centres de communication et de circulation du capital, des lieux où les mots, les idées, les rumeurs, les informations, les biens (y compris les manuscrits, les livres, les pamphlets, les journaux) et les gens venaient souvent d’ailleurs. Thomas Paine, avec ses allers-retours entre Londres, Philadelphie et Paris, en est un exemple parmi d’autres. Même ceux qui ne se sont jamais aventurés loin de leur lieu de naissance, esclaves nés au Nouveau Monde ou philosophes des villes universitaires de Prusse, étaient impliqués dans un système mondial de commerce, dans une République des Lettres aux frontières toujours plus évanescentes ou dans des conflits entre empires, et parfois dans tout cela à la fois. Cette tension entre la stase et le flux, le local et le global, est au cœur de ce livre. Dès son apparition, le sens commun, avec ses inflexions culturelles particulières et ses prétentions à l’universalité, a fait partie intégrante de la vie urbaine du monde atlantique au XVIIIe siècle (22).
La deuxième évolution majeure, c’est l’essor, dans ces villes petites et grandes, catholiques, protestantes ou multireligieuses, d’un nouveau type social : l’homme (et bientôt la femme) désireux de s’affirmer, par le théâtre, le roman, l’essai, l’article, l’édition, le pamphlet, le libelle philosophique, la lecture, la harangue de rue, en porte-parole indépendant(e) de la vérité. Les gens de lettres, au XVIIIe siècle, ne représentaient pas une classe sociale ou un type institutionnel particulier. Nous allons rencontrer certains de leurs représentants, du libertin débauché en rupture de ban avec sa famille noble, comme le marquis d’Argens, à l’ecclésiastique campagnard et sans fortune devenu professeur de morale comme James Beattie, en passant par l’artisan querelleur ou le pamphlétaire radical à la Thomas Paine. Leurs rangs se sont beaucoup élargis au cours du siècle, jusqu’à englober aussi des femmes : nous irons ainsi à la rencontre de la dramaturge révolutionnaire française Olympe de Gouge, de la contre-révolutionnaire anglaise Hannah More et des personnages fictifs de Mère Gérard et de Mère Duchesne, en veillant à ne pas oublier que les présupposés concernant les rapports entre les femmes et le sens commun ont toujours été complexes. Nombre de ces personnages étaient enracinés dans la culture protestante, avec sa longue tradition de valorisation du quotidien par rapport à l’exceptionnel et de l’expérience immédiate par rapport à la réflexion abstraite, soit comme vocation, soit comme recherche du salut et de la vérité dans la vie de tous les jours. Au XVIIIe siècle, cependant, les partisans du sens commun pouvaient aussi venir du catholicisme romain ou de certains milieux hétérodoxes, et même de certains cercles athéistes. En termes économiques, le succès de ces personnages est lui aussi très variable. Au gré des circonstances, certains d’entre eux ont occupé des postes officiels dans des Églises, des universités ou des gouvernements, obtenu les bonnes grâces de protecteurs privés, vécu aux crochets de leur famille ou tenté de survivre de leur seule plume.
Mais ce que les gens de lettres, hommes ou femmes, avaient en commun au XVIIIe siècle, et ce en vertu de la tâche qu’ils s’étaient assignée, c’était le besoin de définir leur propre fonction en des termes qui étaient à la fois sociaux et épistémologiques. La plupart, en réalité, n’avaient guère de considération pour les gens du commun, en particulier pour ceux qui n’appartenaient pas au public instruit qui se trouvait derrière cette force sociale éclairée et nouvelle (et sur laquelle les historiens sont bien documentés) : l’opinion publique (23). Même à l’apogée des révolutions américaine et française, et même chez ceux qui devaient être appelés à jouer un rôle crucial dans leur apothéose moderne, rares sont ceux qui ont exprimé autre chose que de l’horreur à l’idée même de « démocratie », à partir du moment où le mot faisait disparaître ce qui les distinguait de la populace. Mais, au XVIIIe siècle, dans le contexte d’une crise de l’autorité qui avait commencé avec la Réforme et qui se poursuivait avec la science nouvelle, les gens de lettres ont eu de plus en plus tendance à vouloir se faire un nom en s’attaquant, dans le domaine de la philosophie, de la religion ou du gouvernement, aux personnes dotées d’un statut social ou d’une autorité intellectuelle supérieurs. Et dans cette entreprise, ils ont fini par asseoir de plus en plus leur propre légitimité sur une autre autorité abstraite – « le peuple » – et à formuler des revendications pour défendre le rapport non intellectuel et même anti-intellectuel qu’elle entretenait avec le monde, avant de parler, plus tard, en son nom. Les gens ordinaires, hommes et femmes, étaient déjà, bien sûr, des participants actifs du monde politique de l’Europe urbaine, et ce bien avant que ces gens de lettres « éclairés » daignent célébrer l’aptitude des gens « du commun » au jugement pratique et moral. Élément fondamental de la culture politique du début de la modernité, l’action collective populaire – la pétition, l’émeute alimentaire, la manifestation contre l’impôt, la rébellion – doit être considérée comme une remise en cause insistante des prétentions des gouvernants à l’exclusivité de la souveraineté politique. Mais, au XVIIIe siècle, les tensions sociales – chez ceux que nous pouvons appeler des intellectuels, du côté des autorités que ceux-ci espéraient à la fois stimuler et remplacer, et chez les gens du peuple au nom desquels ils prenaient si souvent la parole, mais qu’ils méprisaient et connaissaient si mal – sont d’une importance cardinale pour comprendre l’apparition d’une forme de politique fondée sur l’idée de sens commun. À mesure qu’ils réfléchissaient à la précarité de leur propre situation sociale, ces porte-paroles ont directement ouvert la voie (quoique souvent de manière accidentelle) à la transformation des gens ordinaires en participants politiques actifs, principalement sous la forme d’électeurs. Ils ont également contribué à une transformation de la politique elle-même : perçue comme une science ésotérique et complexe, accessible seulement par une longue étude, la politique s’est muée en quelque chose qui pouvait être présenté comme étant en parfaite adéquation avec le sens pratique et les capacités perceptuelles et intellectuelles élémentaires des gens ordinaires.
La troisième évolution, et peut-être la plus importante, comme il convient à un ouvrage sur la conceptualisation, la production et la circulation du savoir, concerne la relation entre la censure et ce que nous appelons aujourd’hui la « liberté d’expression ». L’histoire du sens commun est profondément liée à l’histoire des expériences faites en matière de modification et de réduction des régulations formelles pesant sur la pensée, la parole et le texte imprimé, si importantes dans le récit libéral (au sens politique du mot) du XVIIIe siècle, de part et d’autre de l’Atlantique. Les principaux moments de ce récit sont, entre autres : la fin du Licensing Act en Angleterre, dans les années 1690, qui fut un des premiers grands exemples de dérégulation de la presse ; la formation de petits espaces de tolérance de fait pour les idées hétérodoxes dans certaines villes protestantes du Continent ; la mention explicite du droit à la liberté d’expression dans les premières constitutions des États américains, puis le Premier Amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique ; enfin la définition de la liberté d’expression en tant que droit humain dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (laquelle, si elle a débouché sur la restauration d’une censure draconienne sous Napoléon, a servi de norme aux mouvements démocratiques européens du siècle suivant). Mais l’histoire du sens commun s’inscrit aussi dans l’histoire concomitante d’un appel continu à des formes plus ou moins explicites de censure comme moyen de stabilité politique, d’harmonie sociale et de détermination efficace de la vérité.
Dans les périodes où la loi limitait fortement le domaine de ce qu’il était acceptable d’exprimer en public, y compris en régulant et en contrôlant le livre et l’imprimerie, demander à parler en se réclamant du sens commun a pu constituer un moyen, comme en Europe continentale au XVIIIe siècle, de remettre en cause les autorités en place ; c’est également devenu un moyen de légitimer la contestation politique ou religieuse. Là, en revanche, où la liberté de conscience associée à la dérégulation des idées a produit une prolifération étourdissante et une diversité inquiétante d’opinions et, de fait, une sorte d’« explosion du savoir » comparable à la saturation d’informations de notre monde dominé par Internet, l’appel au sens commun a pu aussi jouer dans l’autre sens. Il a ainsi souvent servi de mécanisme visant non pas à demander un retour à des formes strictes de régulation mais à imposer de manière informelle un niveau minimum de conformité (appelé aussi autocensure), jugé nécessaire, disait-on, à l’existence de communautés stables et d’un domaine sûr et délimité de vérité. Car qualifier une chose d’absurde, d’incongrue ou de folle était le moyen idéal pour empêcher qu’elle fût jamais prise au sérieux. À l’inverse, considérer une chose comme relevant du sens commun, c’était poser, dès le départ, le fondement d’un savoir à venir et d’un sentiment partagé du bien commun, et faire contrepoids à un relativisme ou un scepticisme dangereux. Et ce, sans avoir à imposer une orthodoxie venant d’en haut (même si, comme nous le verrons, les serments de fidélité aux nouveaux corps politiques ont souvent compliqué, temporairement, les choses). Il n’est donc pas étonnant que la culture du sens commun ait fini par être considérée comme une panacée politique, non seulement pour construire au nom du peuple une forme effective de gouvernance, mais aussi, plus tard, pour assurer la survie pacifique de la souveraineté populaire.
Ces dernières années, des spécialistes de droit se sont intéressés, non sans admiration, à la fonction de cet ensemble informel de règles, c’est-à-dire à ce qu’ils appellent des « normes sociales », dans le monde d’aujourd’hui. Dans de nombreux domaines de notre société, affirment-ils, des normes intériorisées ont pris la place des lois formelles en tant que formes effectives de contrainte, du moins dans la mesure où l’obéissance à ces normes permet de ne pas attirer l’attention sur soi et donne un avantage en termes de bien-être économique ou de statut, et où leur violation ou leur contournement entraîne des sanctions sociales. Ces normes devraient être préservées et encouragées, disent-ils encore, parce que les lois informelles permettent aux gouvernements de faire moins et sont souvent, de fait, plus efficaces que la coercition étatique en matière de contrôle des comportements ou de formation d’une solidarité sociale (24). L’encouragement d’une forme de sens commun national, en particulier au moyen d’une scolarisation précoce des individus, semblerait correspondre à ce modèle. Mais, comme le rappelle le sociologue Pierre Bourdieu, le sens commun, en l’absence de censure régulatrice, peut devenir et est même devenu une sorte de censure structurelle ou constitutive. Mué en instrument spectaculaire de domination, il permet à la fois de contenir les individus de façon permanente et silencieuse, d’exclure les voix déjà gardées à l’écart, jugées soit criminelles soit délirantes, et de limiter le cadre du débat public (25). Cela se traduit par une forme de conformité qui peut être définie comme une dépolitisation du domaine public, et par le remplacement de la légitime lutte intellectuelle par un consensus mécanique (26). C’est en tout cas ce qu’espéraient de lui ses principaux avocats, depuis les premiers grands hommes de presse, Joseph Addison et Richard Steele, dans le Londres du début du XVIIIe siècle, jusqu’aux prêtres réfractaires et sans emploi qui ont alimenté, à Paris, la médiocre propagande royaliste des premières années de la Révolution française. L’histoire de l’évolution des lois touchant la régulation de la contestation est donc tout à fait essentielle si l’on veut écrire une histoire du sens commun, de ses origines à ses conséquences.
À la lumière de ces évolutions historiques plus larges, il apparaît clairement que rien de ce qui touche le sens commun n’est ou n’a été ce qu’il paraît à première vue. Le sens commun évoque peut-être (encore) quelque chose d’universel, de permanent, d’inattaquable, de non idéologique, enraciné dans l’expérience ordinaire de tout un chacun, une sorte de sagesse infaillible du cœur. C’est ainsi, bien sûr, qu’il est utilisé par les politiciens, les conseillers en communication et les publicitaires d’aujourd’hui, qui l’opposent volontiers à la complexité, à l’expertise, au savoir des initiés, à l’urbanité (aux deux sens du terme), au jargon, au conflit, au débat, à l’esprit partisan. Mais, au regard de l’histoire, il apparaît à la fois que les principes du sens commun varient selon les époques et selon les cultures, et que ce qui est considéré comme sens commun n’est jamais tout à fait consensuel, même pour les contemporains. Après tout, le sens commun tend à être défini et conforté – bien qu’il soit associé dans le discours au « sauvage », à l’« homme naturel », au travailleur, au paysan et à d’autres créatures qui n’ont pas été encore salies par la politique ou par une éducation pédante – par des élites qui sont quant à elles concentrées dans les villes et qui ont accès au texte imprimé ; et c’est bien là une forme de médiation dont il ne devrait pas avoir besoin. En pratique, le sens commun sert également à créer autant de nouvelles formes d’exclusion que de formes d’identité ou de solidarité entre les classes. Car le sens commun existe toujours par opposition à d’autres conceptions réputées superstitieuses, marginales ou illusoires, d’une part, ou hyper-abstraites, spécialisées et dogmatiques, de l’autre. De fait, les principes du sens commun eux-mêmes indiquent souvent des directions opposées et renforcent des conceptions conflictuelles. (Il n’est que de considérer les conclusions multiples et contraires que l’on peut en effet tirer du propos banal qui ouvre ce livre : « Chassez le naturel, il revient au galop. ») C’est pourquoi on ne saurait être surpris que le sens commun ne soit invoqué, et considéré comme faisant autorité, que dans les moments de crise des autres formes de légitimité. Les révolutions, qui, par définition, ont pour effet de briser les liens de fidélité et de suspendre les règles dans de nombreux domaines à la fois, en sont une illustration. Sans cela, le sens commun n’a aucun besoin d’attirer sur lui l’attention (27). Cela veut donc dire que l’appel au sens commun, dans la vie publique, est presque toujours polémique : il s’agit d’affirmations sur le consensus et sur la vérité qui sont utilisées à des fins particulières, partisanes et déstabilisatrices. Au lieu de mettre un terme aux conflits, l’évocation du sens commun ne fait qu’en provoquer de nouveaux, devenant le pivot autour duquel, malgré les appels fervents de ses partisans à la modération et à l’universalité, peuvent éclater des différends parfois violents. En tant que forme présumée de savoir, le sens commun ne peut donc être séparé du pouvoir ou de la contestation. En quoi cela importe-t-il ? En ce que ces tensions ou ces paradoxes sont, aujourd’hui encore, au cœur de la réaction populiste aux promesses non tenues de la démocratie.
En définitive, cet ouvrage devrait être abordé comme un exercice d’histoire philosophique (28). Cela veut dire qu’il a pour but de découvrir ce qui est arrivé dans le passé mais aussi de voir si Hannah Arendt a vu juste. Est-ce vraiment le sens commun, né des expériences quotidiennes et des interactions sociales des gens ordinaires, qui rend possible la démocratie et qui lui permet de durer ? Et, si c’est le cas, à quel prix ? Les pages qui suivent tentent d’apporter à la question la réponse d’une historienne.
Notes
(1) Sur la définition et la signification du sens commun (common sense), voir Karl R. Popper, « Two Faces of Common Sense », Objective Knowledge: An Evolutionary Approach (Oxford, 1973), p. 32-105 ; John Kekes, « A New Defense of Common Sense », American Philosophical Quarterly, 16, n° 2 (avril 1979), p. 115-122 ; Mark Kingwell, « The Plain Truth about Common Sense : Skepticism, Metaphysics, and Irony », Journal of Speculative Philosophy, 9, n° 3 (1995), p. 169-188 ; Marion Ledwig, Common Sense : Its History, Method, and Applicability (New York, 2007) ; et surtout Nicholas Rescher, Common Sense : A New Look at an Old Philosophical Tradition (Milwaulkee, 2005). Tous reviennent, à quelque niveau, sur le texte classique de G.E. Moore, « A Defense of Common Sense », in J.H. Muirhead (dir.), Contemporary British Philosophy (Londres, 1925, 2e série), p. 193-223.
(2) Voir Bruce B. Wavell, Language and Reason (Berlin, 1986), sur le fait que le sens commun est « implicite dans la structure et les usages du langage ordinaire » (p. XXI). Sur la manière dont certaines suppositions primordiales se sont enracinées dans les pratiques élémentaires de la vie quotidienne, voir Peter L. Berger et Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge (New York, 1966).
(3) Sur la tendance des sciences sociales contemporaines à critiquer le sens commun, voir Pierre Guenancia et Jean-Pierre Sylvestre (dir.), Le Sens commun : théories et pratiques, actes du colloque de Dijon (Dijon, 2004), et Fritz von Holthoon et David R. Olsen (dir.), Common Sense : The Foundations for Social Science (Lanham, MD, 1987). Sur l’attitude (parallèle) de censure de la critique littéraire par rapport à ce qui passe pour aller de soi dans la « vie de tous les jours », voir Rita Felski, « The Invention of Everyday Life », New Formations, 39 (1999-2000), p. 15-31, et, plus généralement, Antoine Compagnon, Literature, Theory, and Common Sense, trad. Carol Cosman (Princeton, N.J., 2004, (1998)), p. 193.
(4) Clifford Geertz, « Common Sense as a Cultural System », Antioch Review, 33, n° 1 (1975), p. 5-26, réédité in Local Knowledge : Further Essays in Interpretative Anthropology (New York, 1983), p. 73-93. Les historiens utilisent généralement d’autres termes pour parler des valeurs et des principes fondamentaux et souvent inexprimés d’une culture, dont la psychologie historique, la mentalité, les représentations collectives, les structures de croyance et l’imaginaire social. Mais pour un bel exemple d’historien ayant adopté la méthode de Geertz, voir Robert Darnton, The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History (New York, 1985), p. 23. L’historicité de notre sens commun, apparemment naturel et intemporel, était aussi, dans les années 1970 et 1980, un thème récurrent des théoriciens de la culture, de Roland Barthes à Stuart Hall.
(5) Dans A Theory of Justice (Cambridge, MA, 1971), p. 25-28, et Political Liberalism (New York, 1996), John Rawls souligne qu’une conception stable de la justice doit commencer par la reconnaissance de certains présupposés implicites ou de « convictions de sens commun », partagés par la grande majorité des citoyens des démocraties. Nicholas Tampio, dans « Rawls and the Kantian Ethos », Polity, 39, n° 1 (janvier 2007), p. 72-102, note 88, qualifie cette catégorie rawlsienne de « sens commun démocratique ».
(6) Sur Hannah Arendt, voir le chapitre 6.
(7) Thomas Paine a employé ce terme dans Rights of Man : Being an Answer to Mr. Burke’s Attack on the French Revolution (Londres, 1791), p. 162, pour souligner que les révolutions américaine et française devaient être considérées comme deux combats parallèles contre la monarchie. R.R. Palmer, dans les années 1950, a développé l’idée selon laquelle le déclenchement de toute une série de révoltes et de révolutions transatlantiques à la fin du XVIIIe siècle était dirigé contre le privilège et aspirait à la démocratie ; voir The Age of Democratic Revolution : A Political History of Europe and America, 1760-1800 (Princeton, NJ, 1959-1964). Parmi les critiques récentes de la périodisation et de la géographie de Palmer, et surtout de ses affirmations sur la démocratisation, il faut citer : Wim Klooster, Revolutions in the Atlantic World : A Comparative History (New York, 2009), et David Armitage et Sanjay Subrahmanyam (dir.), The Age of Revolutions in Global Context, c. 1760-1840 (Basingstoke, UK, 2010). J’ai choisi pour ma part une ère des révolutions qui commence bien plus tôt que celui de Palmer (ou de Paine) et dont les relations avec la démocratie sont bien plus ambiguës, même à l’horizon limité du monde de l’Atlantique nord.
(8) Emmanuel Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future, trad. L. Brunschvieg et al. (Paris, 1891), p. 9.
(9) Sur le prestige de l’expérience oculaire et de la vie quotidienne, et sur leur importance pour l’imaginaire politique démocratique, voir respectivement Yaron Ezrahi, The Descent of Icarus : Science and the Transformation of Contemporary Democracy (Cambridge, MA, 1990), p. 61-68, et Thomas Dunn, A Politics of the Ordinary (New York, 1999).
(10) L’expression « autorité épistémique » est empruntée à Don Herzog, Poisining the Minds of the Lower Orders (Princeton, NJ, 1998), p. 532.
(11) Sur la relation entre démocratie et populisme, voir Francisco Panizza (dir.), Populism and the Mirror of Democracy (Londres, 2005) ; Yves Mény et Yves Surel, Par le peuple, pour le peuple : le populisme et les démocraties (Paris, 2000), et l’ouvrage qu’ils ont codirigé, Democracies and the Populist Challenge (New York, 2002) ; et Jack Hayward, « The Populist Challenge to Elitist Democracy in Europe », in Hayward (dir.), Elitism, Populism, and European Politics (Oxford, 2003).
(12) Parmi les principaux ouvrages tentant une définition du populisme, voir : Ghita Ionescu et Ernest Gellner (dir.), Populism : Its Meanings and Natural Charactéristics (Londres, 1969) ; Paul Taggart, Populism (Buckingham, UK, 2000) ; et surtout Pierre-André Taguieff, L’Illusion populiste : de l’archaïque au médiatique (Paris, 2002) ; ainsi que les ouvrages suivants de Margaret Canovan, Populism (New York, 1981), « Populism for Political Theorists? », Journal of Political Ideologies, 9, n° 3 (octobre 2004), p. 241-252, et The People (Cambridge, 2005).
(13) Ernesto Laclau, On Populist Reason (Londres, 2005), note ce fait crucial : le populisme, tout en appelant sans cesse à un « peuple » unifié, n’a en réalité pas de véritable référent, et « le peuple » est davantage une aspiration qu’une réalité sociale. Que « le peuple » soit une construction fictionnelle, une création de la politique plutôt que l’inverse, est également au cœur des ouvrages d’Edmund S. Morgan, Inventing the People : The Rise of Popular Sovereignty in England and America (New York, 1988), et Patrick Joyce, Democratic Subjects : The Self and the Social in Nineteenth-Century England (Cambridge, 1994), qui observe, lui aussi, qu’une part de la séduction exercée par le mot vient de son ambiguïté : se réfère-t-il à l’ensemble des êtres humains ? À un corps national ou citoyen ? Ou à une classe plébéienne ? Et faut-il le mettre au singulier ou au pluriel ?
(14) Michael Kazin, The Populist Persuasion : An American History (New York, 1995).
(15) Sur la Begriffsgeschichte, voir notamment Melvin Richter, The History of Political and Social Concepts : A Critical Introduction (Oxford, 1995) ; Mark Bevir, « Begriffsgeschichte », History and Theory, 39 (2000) ; et Reinhart Koselleck, The Practice of Conceptual History : Timing History, Spacing Concepts (Stanford, CA, 2002).
(16) Sur l’histoire sociale du savoir, le point de départ est Peter Burke, A Social History of Knowledge : From Gutenberg to Diderot (Cambridge, 2000) et son article « A ‘‘Social History of Knowledge’’ Revisited », Modern Intellectual History, 4, n° 3 (2007), p. 521-535. Il y a ici un parallèle étroit avec le champ philosophique connu sous le nom d’« épistémologie sociale » ; voir par exemple Alvin I. Goldman, Knowledge in a Social World (New York, 1999). L’expression « les usages communs » est empruntée à Antoine de Baecque et François Mélonio, Lumières et liberté : les dix-huitième et dix-neuvième siècles, vol. III de Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli (dir.), Histoire culturelle de la France (Paris, 1998), et peut être comprise comme une reformulation de l’histoire des mentalités permettant de rendre compte de la fin de l’idée de distinction entre culture « élitaire » et culture « populaire ».
(17) L’expression « épistémologie historique » a été inventée par l’historienne de la science Lorraine Daston ; voir « The Moral Economy of Science », Osiris, 10 (1995), p. 3-24. Elle a été adoptée par un grand nombre d’universitaires, de Mary Poovey à Arnold Davidson. Ian Hacking, dans Historical Ontology (Cambridge, MA, 2002), évoque un projet très proche concernant les sciences sociales.
(18) Sur cette question, voir mon « Politics, Epistemology, and Revolution », Intellectual News, n° 10-11 (été 2003), p. 64-69, et A Revolution in Language : The Politics of Signs in Late Eighteenth-Century France (Stanford, CA, 2001).
(20) Sur l’importance culturelle de l’intérêt du protestantisme pour la « vie ordinaire », voir Charles Taylor, Sources of the Self : The Making of Modern Identity (Cambridge, MA, 1989), p. 211-233.
(21) Sur la signification changeante et la valeur épistémologique de l’expérience commune au cours de la Révolution scientifique, voir Peter Dear, Discipline and Experience : The Mathematical Way in the Scientific Revolution (Chicago, 1995).
(22) Sur la doxa comme mot utilisé pour évoquer des présupposés partagés et sans examen sur le monde (par opposition à ce dont on peut parler sans être d’accord), voir Ruth Amossy, « Introduction to the Study of Doxa », Poetics Today, 23, n° 3 (automne 2002), p. 369-394. Pour Maurice Blanchot, écrire sur le sens commun est intrinsèquement paradoxal, ou un défi à la doxa, dans la mesure où l’on rend le quotidien sensationnel et l’implicite explicite ; voir son « Everyday Speech », Yale French Studies, n° 73 (numéro spécial sur la vie quotidienne) (1987), p. 12-20.
(23) Mon approche de l’histoire atlantique (laquelle est encore trop souvent bornée au monde anglophone) serait plus justement appelée, d’après la terminologie de David Armitage, histoire cis-atlantique, en ce qu’elle « étudie des espaces particuliers en tant que lieux uniques dans le monde atlantique, et cherche à définir cette unicité comme le résultat de l’interaction entre des particularités locales et un réseau plus large de connexions (et de comparaisons) » ; voir ses « Three Concepts of Atlantic History », in David Armitage et Michael J. Braddick (dir.), The British Atlantic World, 1500-1800 (Londres, 2002), p. 11-27.
(24) Pour un résumé de l’immense littérature sur l’apparition de l’opinion publique en tant que variable politique dans l’Europe du XVIIIe siècle, voir James Van Horn Melton, The Rise of the Public in Enlightenment Europe (Cambridge, 2001). Les attitudes à l’égard « du peuple » seront discutées ici et là dans les chapitres suivants.
(25) Sur les normes sociales, voir Cass Sunstein, « Social Norms and Social Roles », Columbia Law Review, 96, n° 903 (1996) ; Eric Posner, Law and Social Norms (Cambridge, MA, 2000) ; Eric Posner (dir.), Social Norms, Nonlegal Sanctions and the Law (Cheltenham, UK, 2007).
(26) Sur l’approche bourdieusienne du sens commun comme forme menaçante de contrainte et de ruse de l’idéologie bourgeoise, voir Robert Holton, « Bourdieu and Common Sense », in Nicholas Brown et Imre Szeman (dir.), Pierre Bourdieu : Fieldwork in Culture (Lanham, MD, 2000), p. 87-99 ; voir aussi Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes (Paris 1997) et Le Sens pratique (Paris 1980). Sur la notion de censure informelle, y compris le travail de Bourdieu, voir mon « Writing the History of Censorship in the Age of Enlightenment », in Daniel Gordon (dir.), Postmodernism and the Enlightenment : New Perspectives in Eighteenth-Century French Intellectual History (Londres, 2001), p. 117-145.
(27) Voir Françoise Gaillerd, « The Terror of Consensus », in Jean-Joseph Goux et Philip R. Wood (dir.), Terror and Consensus : Vicissitudes of French Thought (Stanford, CA, 1998), pour une critique du consensus comme idée régulatrice conservatrice qui conduit à une dévitalisation du politique. Pour une discussion d’un point de vue politique opposé, voir Glenn Loury, « Self-Censorship in Public Discourse : A Theory of ‘‘Political Correctness’’ and Related Phenomena », Rationality and Society, 6, n° 4 (octobre 1994), p. 428-461.
(28) Sur la relation entre crise sociale et sens commun, voir Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique (Genève, 1972).
(28) Cette expression est empruntée à Bruce Mazlish, « Philosophical History », Intellectual News, 8 (été 2000), p. 117-122. Ici, cette « histoire philosophique » exige de considérer les sujets historiques en termes de questions philosophiques et de tenter de répondre aux interrogations philosophiques par les méthodes empiriques de l’historien.

