Hannah Arendt, la révolution et les droits de l’homme Annonces
mardi 3 décembre 2019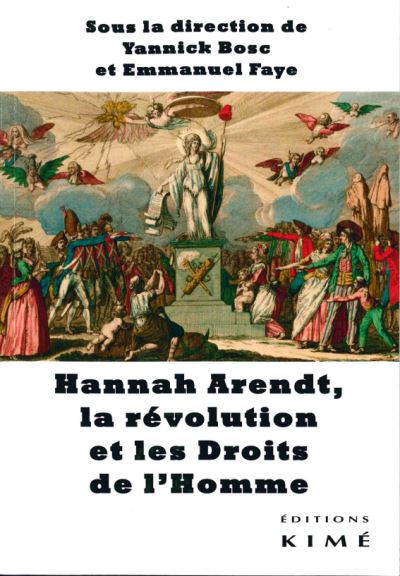
Introduction de l'ouvrage Hannah Arendt, la révolution et les droits de l’homme, Paris, Kimé, 2019, 192 p., sous la direction de Yannick Bosc et Emmanuel Faye.
L’essai De la revolution, paru en 1963, représente, après Condition de l’homme moderne et La crise de la culture, le troisième essai de la série d’ouvrages dans lesquels Hannah Arendt expose sa pensée politique. Arendt se propose de tirer les leçons de l’histoire, en opposant ce qu’elle nomme le « désastre » de la Révolution française, aspirée par « la question sociale », aux leçons d’une révolution supposée réussie, incarnée par la « Déclaration des droits » américaine.
Il importait donc qu’historiens et philosophes analysent ensemble la façon dont Arendt envisage les Révolutions américaine et française et se détermine par rapport à la Déclaration des droits de l’homme et la remise en cause de celle-ci dans la pensée contre-révolutionnaire d’Edmund Burke. La formule arendtienne du « droit à avoir des droits » amorce-t-elle par exemple, comme certains le soutiennent aujourd’hui, un tournant politique dans la considération des droits de l’homme ? Ne représente-t-elle pas plutôt une machine de guerre contre la notion de droit naturel qui se trouve au fondement de ces droits ?
La pensée d’Arendt correspond à la transposition, dans le champ explicitement politique, des « existentiaux » d’ Être et temps de Heidegger : l’être au monde et l’être en commun, ainsi que la reprise de la distinction schmittienne entre le politique et le social. C’est à partir de cette double référence que, faisant sienne la question de l’agir qui ouvre la Lettre sur l’humanisme de Heidegger (1947) et reprenant une formulation de Burke : act in concert, Arendt identifie le politique à l’« agir en commun ». C’est pourquoi la première question que pose son œuvre et sa réception consiste à se demander comment il est possible qu’une conception du politique aussi directement tributaire de la pensée de Heidegger, mais aussi de Schmitt, a pu être considérée comme susceptible de refonder la démocratie et les droits de l’homme.
Sans doute Arendt ne promeut-elle pas les mêmes modèles que Heidegger et Schmitt dans les années 1930. Elle ne parle en effet ni de « principe völkisch », ni d’« État total ». Néanmoins, le geste avec lequel elle récuse toute la philosophie politique depuis Platon jusqu’à Marx est structurellement inspiré par celui de Heidegger invitant au dépassement de l’histoire de la métaphysique de Platon à Nietzsche et à Hegel. Arendt, comme Heidegger, appelle à un « nouveau commencement », et elle indique s’être placée dans les pas de ceux – entendez Heidegger – qui ont entrepris de « démanteler » toute la philosophie avec ses catégories.
De fait, Condition de l’homme moderne, dont Arendt écrit qu’il doit à Heidegger « à peu près tout, à tous égards », développe un paradigme du politique directement fondé dans des distinctions qu’elle lui reprend. Il en va ainsi de la distinction entre zôê et bios, sans fondement dans la langue et la pensée grecque, qu’Arendt emprunte au cours de Heidegger sur Le Sophiste de Platon, suivi en 1924-1925. Elle lui emprunte également la formule de l’arbeitende Tier, devenu sous sa plume animal laborans. Enfin, elle remplace comme lui le problème de l’aliénation (Entfremdung) analysé par Marx, par l’absence de patrie (Heimatlosigkeit) et la désolation (Verwüstung) de l’homme moderne.
En outre, la déploration arendtienne des sociétés de masse égalitaires, son appel à une nouvelle « aristocratie politique », sa façon de considérer la démocratie élective comme le pire des régimes politiques, sa stigmatisation du supposé « acosmisme » du peuple juif et sa déshumanisation complète de tous ceux qui ne sont pas partie prenante d’une communauté politique déterminée consonent très largement avec la vision heideggérienne de la modernité et plus généralement de l’être humain.
Bien entendu, lorsqu’Arendt écrit dans les années 1950 et 1960, nous sommes dans une tout autre époque que lorsque Heidegger et Carl Schmitt publiaient Être et temps et Le concept du politique dans les années 1920 et 1930. C’est maintenant l’époque de la Guerre froide et de la stratégie américaine de réconciliation avec une partie des anciens notables nazis, dans la lutte contre le nouvel ennemi désigné, la Russie soviétique. Or, comme le montre l’introduction intitulée « Guerre et révolution », L’essai De la révolution s’inscrit dans cette dynamique idéologique. Il s’agit, en distinguant « libération » et « liberté », de former un nouveau paradigme de la révolution qui instrumentalise l’histoire en vue de disqualifier la référence à la Révolution française pour mettre en avant la « réussite triomphale » de la Révolution américaine. La thèse géopolitique d’Arendt est explicite : « la dernière chance de survie de la civilisation occidentale réside dans la communauté atlantique ».
Si certains aspects de la pensée d’Arendt, souvent décontextualisés, ont été repris et discutés en philosophie ou en science politique, contribuant ainsi à sa notoriété, les historiens ont pour leur part critiqué très tôt le rapport qu’elle entretient à l’histoire. En 1965, dans une recension qu’il consacre à De la révolution, Eric Hobsbawm déplore son manque de rigueur et une méthode qui semble exclure toute étude sérieuse sur laquelle les thèses défendues par Arendt pourraient être fondées (1). François Furet, dont on pourrait supposer qu’il regarde Arendt avec bienveillance, puisqu’il partage en partie ses choix idéologiques – contrairement à Hobsbawm –, juge son travail historique faible et peu fiable (2). Dans le Dictionnaire critique de la Révolution française publié en 1988, qu’il dirige avec Mona Ozouf, seul l’article traitant de la Révolution américaine rédigé par Philippe Raynaud – qui n’est pas historien, mais philosophe et politiste – consacre un développement significatif à l’interprétation proposée par Arendt dans De la révolution. Aux États-Unis, Keith M. Baker, proche de Furet, dont les travaux ont donné le ton des études révolutionnaires dans le monde anglo-saxon, ne se réfère que marginalement à Arendt. Ainsi, en dépit de la forte emprise du paradigme antitotalitaire sur l’histoire de la Révolution française (3), on ne constate pas une influence des travaux « historiques » d’Arendt chez les historiens, même au sein de « l’école » furétiste. On note plutôt une défiance, la lecture de l’essai Sur la révolution ayant en effet de quoi surprendre les spécialistes tant l’usage du passé y est désinvolte. Au demeurant, certains de ses exégètes le constatent eux-mêmes et estiment qu’Hannah Arendt serait avant tout une conteuse d’histoire (4). Son poids dans la philosophie politique contemporaine n’est pourtant pas celui d’une fabuliste.
Les principaux enjeux de cet ouvrage consistent donc à montrer au prix de quelle instrumentalisation de l’histoire, de quelle conception faussée des révolutions française et américaine et de leurs acteurs, et de quelle mise en pièce de l’idée d’humanité Hannah Arendt est parvenue à imposer une vision du politique qui a rompu avec le principe de l’égalité naturelle entre les hommes. Elle ne défend en effet ni la démocratie ni les droits de l’homme (5).
Le premier chapitre définit les paradigmes arendtiens du politique et de la révolution sur lesquels les chapitres suivants s’articulent. Il contextualise De la révolution, tant sur le plan historique que sur celui du dispositif intellectuel au sein duquel il s’insère. Emmanuel Faye montre ce que la pensée anti-démocratique d’Arendt doit à Heidegger et Carl Schmitt, en particulier quant à la séparation du politique et du social qui ordonne sa réflexion. Inscrit dans la guerre froide – qui n’imprègne pas seulement De la révolution, mais aussi la plupart de ses écrits – l’essai de 1963 a pour objectif de modifier dans les esprits le paradigme de la révolution et les modèles historiques que l’on relie à ce mot, l’expérience américaine devant se substituer à la française, un « désastre » prolongé par le totalitarisme soviétique. Ce captage de la mythologie révolutionnaire de la gauche au profit des États-Unis permet de présenter la guerre idéologique contre l’URSS comme une révolution de la liberté, non une contre-révolution. Or, la liberté promue par Arendt n’est pas celle de tous. Le paradigme arendtien du politique est en effet exclusif, les esclaves, les travailleurs, les ouvriers, les employés, exclus de l’agir politique, relèvent de la sphère sociale et économique caractérisée par la violence et les rapports de domination, celle de l’animal laborans.
Le deuxième chapitre est consacré à la déconstruction des Lumières françaises dans la pensée d’Arendt et ses conséquences politiques. Edern de Barros rappelle qu’Arendt adhère au projet de « démantèlement » de la métaphysique et de récusation de la tradition humanisme des Lumières formulé par Heidegger. Les termes « déconstruction » et « démantèlement », tirés du vocabulaire heideggérien, ne renvoient pas à une entreprise critique en vue d’une reconstruction par la pensée. La vision du monde posée par Arendt est pré-critique. Elle repose sur une destruction de la pensée elle-même et doit être considérée comme un irrationalisme. Arendt se propose de déconstruire l’humanisme à partir d’un mysticisme de la pluralité, insaisissable par la raison, qui est l’antithèse de l’unité du genre humain. L’humanité de l’homme n’apparaît que lorsque l’homme se distingue des membres de son espèce, qu’il renoue avec la pluralité originelle en agissant au sein de l’espace politique exclusif des égaux (une aristocratie). Ce changement de perspective en politique est dirigé contre les droits de l’homme dont l'égalitarisme et les revendications économiques et sociales qu’ils engendrent, ne sont pas considérés comme des moyens de libération mais comme une menace pour la liberté au sens d’Arendt.
Dans le chapitre 3, Marc Belissa décrit la manière dont Hannah Arendt construit une révolution américaine idéologique et biaisée – une révolution des élites, conservatrice et sans contenu social – conçue pour être le contrepoint de la française, telle qu’elle l’imagine. Arendt s’appuie pour cela sur l’historiographie conservatrice américaine, très présente pendant la Guerre froide, qui minore les conflits de la Révolution américaine et souligne le consensus autour des « valeurs américaines » de liberté, de propriété et d’individualisme. Consciemment ou non, ces « historiens du consensus » reprennent les propos d’Edmund Burke sur la différence fondamentale entre les deux révolutions, l’américaine s’étant selon eux déployée autour de valeurs traditionnelles et non sur la base des théories des droits des Lumières. Par ailleurs, elle met en avant les écrits de John Adams qui sont présentés comme la quintessence de la pensée révolutionnaire américaine, alors que les contemporains considéraient ces traités d’un défenseur de la monarchie anglaise et d’Edmund Burke contre la Révolution française, comme des textes monarchistes, contre-révolutionnaires et anti-républicains.
Les deux chapitres suivants traitent du récit de la Révolution française proposé par Hannah Arendt dans De la révolution.
Dans le chapitre 4, Florence Gauthier présente les deux sources principales qui ont inspiré Arendt, d’une part Edmund Burke, que celle-ci porte au pinacle parce qu’il attaque le principe d’une déclaration des droits naturels et imprescriptibles de l’homme et du citoyen et, d’autre part, l’interprétation de la Révolution française selon le « marxisme orthodoxe » qui domine le XXe siècle. La critique de Burke, fin observateur des débuts de la Révolution française, est complexe et l’usage qu’en fait Arendt superficiel. Si elle reprend la qualification burkienne de la théorie du droit naturel comme « abstraction métaphysique », ce que Burke refuse au droit naturel imprescriptible, civil et politique, qui s’impose comme limite constitutionnelle à l’exercice des pouvoirs publics, n’a pas été compris par Arendt. Dans le dernier chapitre, la description qu’elle propose de la Révolution française, tendue vers la dictature centralisée du « parti jacobin » dirigé par Robespierre, est empruntée à l’interprétation marxiste orthodoxe dans sa version stalinienne qui s’est imposée dans les années 1945-1960. Le « parti unique » jacobin fantasmé qu’elle voudrait voir à l’œuvre, procède d’un retournement où la Révolution russe informe finalement de ce qu’aurait été la Révolution française.
L’argumentation que mobilise Arendt est l’objet du chapitre 5. Il est centré sur le personnage de Robespierre qui incarnerait ce que Arendt nomme « la question sociale », portée par un peuple exclusivement concentré sur ses besoins matériels et qui finalement engendrerait la « Terreur ». Yannick Bosc analyse d’abord la manière dont Hannah Arendt manipule les sources qu’elle convoque, afin de fabriquer un Robespierre et un peuple qui lui permettent d’élaborer sa problématique. Confondant les droits naturels de l’homme et la nature physique, elle invente Robespierre en révolutionnaire qui aurait transformé les « Droits de l’Homme en Droits des Sans-Culottes », indifférent à la question politique et obsédé par le monde de l’animal laborans, celui de la « question sociale » dont il serait le principal porte-parole. En affirmant que les droits naturels de l’homme libèrent le pouvoir destructeur de l’animal laborans et génèrent la Terreur, Arendt retrouve, sans la connaître, la principale caractéristique du discours anti-démocratique des thermidoriens. Elle ne raconte cependant pas la même histoire puisque ces derniers dénoncent l’anarchie du peuple politisé là où Arendt dépeint un peuple-ventre et pré-politique. Mais afin de faire le lien entre la « dictature jacobine » et l’URSS qui a réprimé la révolution populaire des soviets, Arendt doit inverser son récit dans le dernier chapitre. Le peuple jusque-là impolitique devient subitement porteur d’une « république du peuple » dont Robespierre serait l’ennemi.
Les deux révolutions sont croisées au chapitre 6, dans lequel Christine Fauré questionne ce qui fait constitution pour Hannah Arendt. Dans la comparaison partisane qu’elle propose de la Révolution américaine et de la Révolution française, Arendt adhère à une vision idyllique de la vie des colonies anglaises et de sa démocratie locale, alors que la France, submergée par ses pauvres est selon elle incapable d’instituer le politique dans une Constitution. Elle disqualifie a priori toutes les tentatives constitutionnelles qui lui apparaissent systématiquement vicieuses. Sieyès, dont elle ne connaît que Qu’est-ce que le tiers état ?, est l’objet de sévères critiques. Il aurait en particulier assimilé le pouvoir constituant à la nation, alors que le pouvoir constituant qu’il imagine est proche des Conventions américaines qui rassemblent des représentants pour faire la constitution. Dans le dernier chapitre de l’essai Sur la révolution Hannah Arendt oppose la verticalité qu’elle croit voir dans la Révolution française à une horizontalité politique qu’elle perçoit à l’état embryonnaire dans les mouvements révolutionnaires du XVIIIe siècle. Jouant toujours les États-Unis contre l’URSS, elle pense en particulier trouver dans « la république élémentaire » de Jefferson un lien avec les conseils révolutionnaires, soviets et Räte qui ont fait leur apparition au XXe siècle.
On pourrait s’attendre à ce que la majorité des écrits d’Arendt, qui semblent hantés par son expérience d’apatride et par la « destruction des Juifs d’Europe », la conduise à voir dans la destruction génocidaire la violation extrême des droits de l’Homme et donc de l’humanité. Edith Fuchs montre dans le chapitre 7 qu’il n’en est rien. Arendt attaque en effet l’idée de droit naturel et tout spécialement celle d’égalité naturelle. Elle soutient que la liberté n’aurait de sens que politique et le célèbre « don de l’action » qui définirait la spécificité humaine est dévolu à l’action politique en commun dont seule est capable l’aristocratie des « égaux ». Les élaborations du droit pénal international et en particulier la notion de crime contre l’humanité sont tenues à l’écart de ses réflexions sur le procès Eichmann. Or ces conceptualisations et ces instances juridiques reposent sur la Déclaration des droits de l’Homme et donc sur l’affirmation de l’universalité humaine. Dire que la liberté, l’égalité ne sauraient être principielles mais toujours politiques, revient à dire qu’elles relèvent nécessairement de l’appartenance à une société politique, ce qui met en cause l’unicité et l’identité de l’humanité.
Pour nombre de commentateurs, le fait qu’Arendt rejette radicalement l’idée de « droits naturels » nous libérerait d’une conception dépassée des droits fondamentaux, fondée sur une soi-disant « nature humaine », notion métaphysique dont il conviendrait de se débarrasser. Ils pensent trouver dans la notion de « droit à avoir des droits » le véritable fondement des droits de l’homme. Dans le dernier chapitre, Benoît Basse examine les arguments qui sont mobilisés en faveur de cette thèse. Tout le problème est de savoir si la conception purement « politique » des droits de l’homme qu’Arendt propose est encore compatible avec l’idée même de droits de l’homme. Les droits de l’homme supposent la citoyenneté pour être effectifs mais est-ce la citoyenneté qui confère l’humanité ? Pour l’auteur de l’essai De la révolution, l’égalité et l’humanité « authentiques » ne sont pas des données, mais s’acquièrent par la participation à l’espace politique dans lequel les hommes se reconnaissent comme des égaux et où ceux qui en sont exclus ne sont pas pleinement humains. A travers « le droit à avoir des droits », la pensée d’Arendt n’est pas celle où l’idée des droits de l’homme prendrait tout son sens, mais celle où l’idée même de droits de l’homme perd toute signification.
Yannick Bosc et Emmanuel Faye
Notes
(1) History and Theory, vol. 4, n°2, 1965, p. 252-259.
(2) François FURET, Inventaires du communisme, Paris, EHESS, 2012.
(3) Michael Scott CHRISTOFFERSON, Les intellectuels contre la gauche. L’idéologie antitotalitaire en France (1968-1981), (2004), trad., Marseille, Agone, 2009.
(4) Seyla Benhabib, « Hannah Arendt and the Redemptive Power of the Narrative », Social Research, vol. 57, n° 1, 1990.
(5) Les contributions de ce volume ont fait l’objet d’une première présentation et discussion lors d’un colloque organisé par Yannick Bosc et Emmanuel Faye à l’Université de Rouen Normandie le 17 avril 2018, avec le soutien de l’ERIAC et du GRHis.

