Albert Mathiez, Robespierre et la république sociale Annonces
mardi 6 mars 2018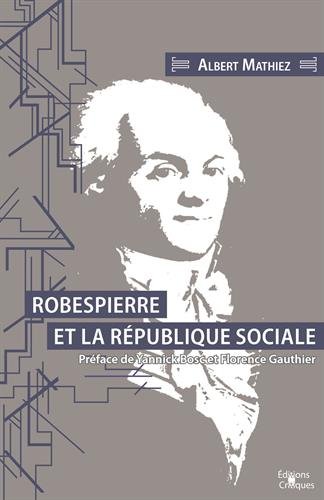
Albert Mathiez, Robespierre et la république sociale, Paris, Éditions Critiques, 2018, 368 p., introduction de Yannick Bosc et Florence Gauthier. L'ouvrage regroupe les principaux textes que Mathiez a consacrés à Robespierre. Nous proposons ici l'un d'entre eux, intitulé "Robespierre", une conférence organisée par le Groupe Fraternel du XIIIe et par la 7e Commission de l'USTICA (Union syndicale des techniciens de l'industrie, du commerce et de l'agriculture), publiée en 1924 par les éditions de la Maison des Jeunes.
Citoyens,
Aucun homme d’État de la Révolution n’a été plus populaire pendant sa vie que celui que les contemporains surnommèrent dès la Constituante du beau nom d’Incorruptible, aucun pourtant n’a été plus tristement calomnié après sa mort ni plus bassement outragé. On imprime couramment, jusque dans les livres scolaires qui servent à l’éducation des enfants de l’école laïque, qu’il fut un pieux calomniateur, un mystique assassin, un hypocrite sanguinaire, un ambitieux sans scrupules, on lui dénie jusqu’au talent, jusqu’à l’éloquence. On en fait un cerveau médiocre, une âme rétrécie. Quand ces gentillesses s’étalent sous la plume d’académiciens, d’écrivains bien-pensants, de remparts de l’ordre établi, cela s’explique, et il est naturel que Robespierre, qui a incarné la démocratie la plus hardie et qui l’a faite triompher tant qu’il a vécu, soit toujours poursuivi par la haine des ennemis de la justice et du progrès.
Qu’il soit méconnu aussi par les professionnels de la politique, qui ne voient dans la Révolution française qu’une réclame électorale, que ceux-ci raillent sa vertu qui les importune, qu’ils essaient de salir sa radieuse mémoire, cela s’explique encore. Danton fait bien mieux leur affaire et trop d’entre eux sont poursuivis par le spectre de Banco.
Mais que des historiens qui prétendent au titre de savants, que des professeurs de Sorbonne qui se disent et qui se croient peut-être des démocrates, fassent leur partie dans ce concert, voilà qui étonnerait et qui scandaliserait, si on ne réfléchissait pas que les historiens eux-mêmes sont de leur temps, qu’ils cèdent aux passions et à la mode du jour et que bien peu sont capables de rendre à la vérité un hommage impartial et désintéressé.
Vous n’attendez pas de moi que je réponde ici à tous ces beaux esprits. J’ai réfuté ailleurs et en détail, dans les 15 volumes des Annales Révolutionnaires et dans mes différents ouvrages (1), les plus notoires de leurs erreurs et de leurs impostures. Mes démonstrations sont restées sans réplique, et je peux dire que j’ai réduit l’adversaire au silence. La vérité aura son jour, qui est proche, puisqu’aussi bien j’ai pu constater déjà que la plupart de mes conclusions ont été adoptées par l’historien qui a signé l’an dernier le volume de la Convention dans la collection de l’Histoire de France, publiée chez Hachette, je veux parler de mon collègue de Strasbourg, M. Georges Pariset.
Laissons donc ces polémiques. Le temps fera son œuvre, et efforçons-nous seulement, ce soir, de retracer sommairement la vie du plus grand de tous les révolutionnaires, en marquant au passage, les services inoubliables qu’il a rendus à la cause qui nous est chère.
La jeunesse
Il est né à Arras en 1758 d’une famille modeste. Son père était avocat sans fortune, sa mère fille d’un brasseur. Il a connu de près le peuple, et le malheur l’en a encore rapproché.
À l’âge de 6 ans, il a perdu sa mère, à 8 ans il a perdu son père qui, désespéré, quitta le pays, sans qu’on le revît (2). L’aîné de deux sœurs et d’un frère il était orphelin et chef de famille à un âge où on joue encore aux billes. De là vint sans doute le sérieux de son caractère et le profond sentiment du devoir qui en fut le trait dominant.
Doué d’une sensibilité très vive, d’un naturel plein de douceur, la souffrance des autres lui faisait mal. Il adorait les bêtes. Il pleura quand sa sœur Charlotte laissa mourir, par négligence, son pigeon favori. Pendant que son frère et ses sœurs étaient recueillis par son grand-père, le brasseur Carraut, et par ses tantes, il faisait, grâce à une bourse de l’abbaye de Saint-Waast, d’excellentes études au collège Louis-le-Grand, à Paris, et il s’attirait l’amitié de ses camarades et l’estime de ses maîtres. Ses études terminées, il quitta le collège avec le certificat le plus flatteur, qu’accompagnait une gratification de 600 livres, la plus élevée qui ait été accordée à ses condisciples. Le collège était si content de lui qu’il continua sa bourse à son frère Augustin.
C’est vers ce moment que Robespierre eut avec J.-J. Rousseau, à Ermenonville, un entretien qui laissa dans son esprit une trace ineffaçable. « Je t’ai vu, dans tes derniers jours, a-t-il écrit plus tard, en parlant de l’immortel auteur du Contrat social, et ce souvenir est pour moi la source d’une joie orgueilleuse, j’ai contemplé tes traits augustes, j’y ai vu l’empreinte des noirs chagrins auxquels t’avaient condamné les injustices des hommes. Dès lors j’ai compris toutes les peines d’une noble vie qui se dévoue au culte de la vérité. Elles ne m’ont pas effrayé. La conscience d’avoir voulu le bien de ses semblables est le salaire de l’homme vertueux ; vient ensuite la reconnaissance des peuples qui environne sa mémoire des honneurs que lui ont destinés ses contemporains. Comme je voudrais acheter ces biens au prix d’une vie laborieuse, au prix même d’un trépas prématuré ! » Tout l’homme est déjà dans ce cri de l’adolescent. Il se dévouera à l’idéal tracé par Jean-Jacques et déjà il prévoit qu’il laissera la vie dans la lutte.
Avocat au barreau d’Arras, il fut vite entouré d’une réputation de talent et d’intégrité. Il refusait de plaider les mauvaises causes. Il faisait, à l’occasion, dans ses plaidoyers, le procès des abus de l’ancien régime, des lettres de cachet, par exemple. Un de ses plaidoyers, qu’il prononça pour défendre contre la malveillance et la routine un homme de progrès qui avait installé un paratonnerre sur sa maison, eut un grand retentissement et fut signalé avec éloges jusque dans la presse parisienne. L’Académie d’Arras s’empressait de lui ouvrir ses portes dès 1783. Il avait 25 ans. Dans son discours de réception, il s’élevait avec force contre le préjugé qui fait rejaillir sur les parents d’un criminel l’infamie attachée à son supplice. Ce discours, remanié et complété, fut couronné peu après par l’Académie de Metz. Il rédigeait ensuite tout un mémoire pour protester contre l’odieuse législation qui privait les bâtards de la succession de leurs parents. Il écrivait encore l’éloge du président Dupaty, le bon juge de cette époque, qui s’était rendu célèbre en dénonçant plusieurs erreurs judiciaires, et il attaquait avec force la jurisprudence criminelle, « qui semble, disait-il, avoir été faite pour un peuple barbare ». Il louait enfin Dupaty « d’avoir fixé surtout ses regards sur cette classe malheureuse de citoyens qui n’est comptée pour rien dans la société, tandis qu’elle lui prodigue ses peines et ses sueurs, que l’opulence regarde avec dédain, que l’orgueil appelle la lie du peuple ».
Bref, il tenait le serment qu’il s’était fait à lui-même après son entrevue avec Jean-Jacques. Il combattait au premier rang les iniquités de la société, il préparait les esprits à la Révolution prochaine et il voulait la faire tourner, non au profit de la bourgeoisie, mais du peuple.
Tout absorbé qu’il fût par son apostolat, il n’avait rien de l’ascète rigide et perdu dans le rêve qu’on s’est plu à imaginer. Il était jeune et il connut les joies de la jeunesse. Il y avait à Arras une société de bons vivants et de gais buveurs qui se réunissaient de temps en temps pour vider sous un berceau de roses quelques coupes de vin rosé en récitant des vers légers. Robespierre figura parmi ces Rosati. Avec eux, il taquina la muse amoureuse et bachique. Des sots et des ignorants ont prétendu qu’il aurait eu pour la femme une sorte de répulsion instinctive. Quelle erreur ! Il recherchait, au contraire, la société du beau sexe, et c’est parmi les femmes qu’il compta jusqu’à la fin de ses ferventes admiratrices. À l’une d’elles il décochait ce joli madrigal :
Crois-moi, jeune et belle Ophélie,
Quoi qu’en dise le monde et malgré ton miroir,
Contente d’être belle et de n’en rien savoir,
Garde toujours ta modestie.
Sur le pouvoir de tes appas
Demeure toujours alarmée,
Tu n’en seras que mieux aimée
Si tu crains de ne l’être pas.
Ses poésies de jeunesse, qui ont été conservées, forment tout un petit volume.
Ses succès auprès des dames étaient si connus qu’un de ses confrères des Rosati, M. de Fosseux, qui sera maire d’Arras sous la Révolution, les rappelait ainsi un jour : « Robespierre n’ouvre la bouche que pour faire entendre les accents de l’éloquence. Avec quel plaisir on l’écoute ! On ne peut pas s’empêcher de le croire fait pour siéger parmi les Rosati, quand on le voit se mêler parmi les pastourelles du canton et animer leurs danses par sa présence. C’est le dieu de l’éloquence qui se familiarise parmi les mortels et qui, sous le costume d’un berger, laisse encore apercevoir les rayons de la divinité. »
Voilà ce que pensait de Robespierre, de son talent et de son caractère, à la veille de la Révolution, un des hommes les plus importants de l’Artois.
Heureusement, Robespierre n’était pas de ces hommes qui oublient leur devoir au fond d’une coupe de champagne ou aux pieds des pastourelles ; quand s’ouvrit la crise de 1789 qu’il attendait, il était prêt. Il se jeta dans la bataille avec une belle résolution. Contre les privilégiés il multiplia les brochures hardies et convaincantes, tel son Appel à la Nation Artésienne qui eut deux éditions au début de la campagne électorale, tel son Avis aux habitants des campagnes où il disait aux paysans : « Vous, nourriciers de la patrie, vous, sur les bras de qui, en dernière analyse, pèsent tous les impôts, songez à secouer l’oppression qui vous accable ! » Alors que tous les écrivains du tiers-état mettaient leur plume au service de la bourgeoisie, lui, toujours fidèle à la pensée de Jean-Jacques, il allait droit au 4e État, à ceux qui produisent et qui peinent. C’est un fait significatif qu’en même temps qu’il essayait de galvaniser les paysans il rédigeait le cahier des doléances des savetiers d’Arras. Ce cahier est tout entier de son écriture. Quand s’ouvrirent les élections, à l’assemblée du tiers d’Arras, il releva vertement un échevin de la ville – c’était justement son ami Dubois de Fosseux – qui avait plaisanté le savetier Lantillette : « Eh quoi ! avait dit l’échevin, Lantillette pourra donc être aussi maire ? » Pour Robespierre le savetier Lantillette, délégué par sa corporation, était l’égal en dignité des bourgeois les plus huppés et il leur était supérieur en utilité.
Personne plus que Robespierre n’eut conscience de l’éminente dignité des travailleurs, et à cette date c’était une grande nouveauté.
Quelques jours plus tard, les ordres privilégiés de l’Artois ayant averti le tiers-état assemblé qu’ils renonçaient à leurs privilèges pécuniaires, comme le lieutenant général du baillage qui présidait proposait d’envoyer une délégation aux nobles et aux prêtres pour les remercier de leur sacrifice volontaire, Robespierre se leva et fit écarter la motion en disant qu’on ne devait pas de remerciements à des gens qui n’avaient fait que renoncer à des abus en restituant au peuple ce qui lui appartenait. Quoi d’étonnant dès lors que les paysans et les artisans de l’Artois enthousiasmés, ravis d’avoir trouvé un défenseur tout à eux, l’aient choisi, malgré son jeune âge, il avait à peine 31 ans, pour les représenter aux États généraux ?
La Constituante
Jamais confiance ne fut mieux placée. À la Constituante, il prit position en avant de la Révolution. Il répéta sans cesse, avec un esprit de suite et une ténacité qui en imposèrent, que l’œuvre de la Révolution ne devait pas se borner à remplacer une classe par une autre, les privilégiés de la naissance par les privilégiés de la fortune. Dans toutes les circonstances, il prit le parti de ceux qui n’étaient pas représentés dans l’assemblée bourgeoise, de ceux que l’on appelait alors les sans-culottes, parce qu’ils portaient le pantalon, et que nous appelons aujourd’hui les prolétaires.
Avec un courage indomptable il dénonça les violations répétées des principes de la Déclaration des droits que l’Assemblée commettait dans leur application. Dès le mois d’octobre 1789, il protesta contre la distinction des Français en citoyens actifs, seuls pourvus du droit de vote parce que seuls en état de payer des impôts déterminés, et en citoyens passifs, exclus de la cité parce qu’ils ne possédaient que leur travail. Ses discours contre le marc d’argent, c’est-à-dire contre la somme d’impôt fixée pour être éligible, furent réimprimés dans toute la France. Nulle campagne ne le popularisa davantage. La société des indigents amis de la Constitution lui vota des félicitations enthousiastes.
L’Assemblée réserva la garde nationale à la seule bourgeoisie. Mais Robespierre réclama des armes pour le peuple. Il voulut ouvrir à tous les citoyens cette garde nationale qui était l’armée de la Révolution. C’était plus hardi, estime Jaurès, que de leur accorder le droit de grève, car, comme l’a dit Blanqui, « qui a du fer a du pain ».
Déjà, quand la Constituante avait voté, à la fin d’octobre 89, la terrible loi martiale pour réprimer les troubles provoqués par le haut prix des subsistances, Robespierre s’était efforcé d’empêcher la bourgeoisie de se servir de ses armes contre le peuple affamé et désarmé qui demandait du pain.
Bien entendu, l’Assemblée ne le suivit pas davantage quand il lui proposa d’ordonner une enquête sur les usurpations de biens communaux que les seigneurs avaient commises en vertu du droit de triage.
À maintes reprises, il prit la défense des comédiens et des juifs, de tous les parias de la société. Il fut assez heureux pour faire décider que le droit d’aînesse serait aboli et que désormais les enfants auraient un droit égal à l’héritage de leurs parents. À cette occasion il laissa entrevoir le système social de ses rêves : « Législateurs, disait-il, vous n’avez rien fait pour la liberté si vos lois ne tendent pas à diminuer, par des moyens doux et efficaces, l’extrême inégalité des fortunes. » Il comprenait que l’égalité politique est peu de chose sans l’égalité sociale.
À force d’éloquence et de logique il parvint à empêcher l’Assemblée d’enlever aux citoyens passifs le droit de pétition. « Je défendrai surtout les plus pauvres, s’écriait-il le 7 mai 1791. Plus un homme est faible et malheureux, plus il a besoin du droit de pétition ! »
La préoccupation sociale qui, dès cette époque, était chez lui la dominante, ne cachait pas à Robespierre les problèmes politiques. Jaurès a bien vu que loin d’avoir été un simple doctrinaire, amoureux de logique, il fut au contraire un homme d’État très réaliste, attentif aux moindres événements ; qu’il n’avait rien d’un utopiste, ni d’un esprit vague. Comprenant que les privilèges allaient s’abriter derrière la prérogative royale pour esquisser un retour offensif, il s’appliqua à réduire au minimum les pouvoirs laissés au roi par la Constitution. Il combattit avec énergie le veto. À toutes les crises décisives, on le voit intervenir. Au matin du 5 octobre 1789, quand l’émeute des femmes parisiennes est déjà en marche sur Versailles, il prononça une véhémente attaque contre le roi qui avait refusé de sanctionner les arrêtés du 4 août et la Déclaration des droits. Il fit décider que le veto royal ne pourrait s’appliquer aux lois constitutionnelles, et peu après, quand Maillard, à la tête des femmes, parut à la barre de l’Assemblée, ce fut encore Robespierre qui appuya ses revendications. Il n’avait donc pas peur de se solidariser avec l’émeute, quand l’émeute commençait à peine et quand on ignorait encore si elle triompherait !
Quand éclatèrent, quelques mois plus tard, les mutineries militaires provoquées par les brimades des officiers, tous nobles, contre les soldats, tous roturiers, Robespierre prit encore hautement ses responsabilités. Alors que ses amis du côté gauche se contentaient d’exiger des officiers un serment civique, il demanda, lui, le licenciement de tous les officiers nobles et la reconstitution de l’armée sur une base démocratique. Quand on réforma les conseils de guerre, il demanda qu’ils ne fussent pas composés uniquement d’officiers, mais par parties d’officiers et de soldats. « L’accusé, disait-il, devait être jugé par ses pairs. » Aucun révolutionnaire n’eut au même degré la défiance de la caste militaire. Il disait que de toutes les aristocraties, une seule avait été épargnée par la Révolution : celle des officiers. Il disait encore que « l’esprit de despotisme et de domination est naturel aux militaires de tous les pays ».
On peut dire sans exagération que sa clairvoyance politique ne fut jamais en défaut. Il comprit de bonne heure que les meneurs du côté gauche de la Constituante : les Adrien Duport, les Lameth et Barnave, les triumvirs, étaient perdus pour la Révolution le jour où il les vit s’efforcer d’enlever le droit politique aux hommes de couleur libres dans les colonies. Ils avaient été ses amis : il n’hésita pas à rompre avec eux et il dénonça dès lors leurs trahisons avec une vigueur admirable. Il devina leurs ambitions et leur rapprochement secret avec la Cour et, pour y couper court, il fit voter, le 16 mai 1791, par un discours merveilleux de logique et de passion, l’exclusion de tous les Constituants de l’Assemblée suivante. Les triumvirs ne lui pardonnèrent pas ce coup terrible. Mais Robespierre ne faisait pas partie de la République des camarades.
La fuite de Louis XVI à Varennes ne le prit pas au dépourvu. Alors que la plupart se désolaient et gémissaient, le soir même du 21 juin, il s’écriait joyeusement aux Jacobins : « Ce n’est pas à moi que la fuite du premier fonctionnaire public devait paraître un événement désastreux. Ce jour pouvait être le plus beau de la Révolution. Il peut le devenir encore, et le gain de 40 millions d’entretien que coûtait l’individu royal serait le moindre des bienfaits de cette journée. » Et il se mit à dénoncer « le lâche et grossier mensonge » par lequel l’Assemblée apeurée avait appris à la France que le roi ne s’était pas enfui, mais avait été « enlevé ». Nul doute que Robespierre eût été heureux que le roi parjure parvînt à gagner la frontière. Sa colère fut vive quand il vit les triumvirs proposer de le remettre sur le trône.
Il prononça, le 14 juillet 1791, contre l’inviolabilité royale, un discours qu’un juge, qui n’est pas suspect de partialité, M. Aulard, considère comme « un des plus puissants que la Constituante ait entendu ». Il y demandait que le peuple fût consulté sur la question du maintien de la royauté et du jugement de Louis XVI.
Trois jours plus tard, les républicains qui signaient au Champ de Mars une pétition contre Louis XVI étaient massacrés par la garde nationale bourgeoise commandée par La Fayette et Bailly.
Pendant la petite Terreur qui suivit le massacre, Robespierre fut admirable de fermeté et de courage. Presque seul de tous les députés, il resta aux Jacobins (3). Il les anima de son énergie, il les empêcha de se dissoudre, et il dénonça à la France les manœuvres et les trahisons des Lameth et des Barnave, passés au service de la Cour. Grâce à ses efforts, les Feuillants ne purent réussir à faire subir à la Constitution la transformation profonde qu’ils avaient méditée et promise au roi.
Quand l’Assemblée se sépara, Robespierre était devenu le vrai chef, le chef reconnu du parti démocratique. Sa popularité était déjà immense. Les Parisiens dételèrent sa voiture le dernier jour de la Constitution et le portèrent en triomphe. Les gens d’Arras et les gardes nationales de l’Artois allèrent à sa rencontre jusqu’à Bapaume et lui offrirent une couronne civique. Ses concitoyens illuminèrent leurs maisons quand il rentra au foyer.
Ce n’était pas seulement le peuple, qu’il avait défendu de toute son âme, qui l’adorait, mais la bourgeoisie révolutionnaire elle-même mettait en lui ses plus fermes espoirs. Le jeune Saint-Just, encore inconnu, lui avait écrit dès le 19 août 1790, de son village de l’Oise : « Je ne vous connais pas, mais vous êtes un grand homme. Vous n’êtes pas seulement le député d’une province, vous êtes celui de l’humanité et de la république. » Mme Roland, qui le déchirera plus tard dans ses Mémoires, lui vouait alors une admiration sans bornes, dont témoignent ses lettres intimes. Mme de Chalabre, une femme fortunée, enthousiaste de la Révolution, l’attirait dans sa maison et entretenait avec lui une correspondance suivie. Son nom était devenu, pour les Jacobins de toute la France, le symbole de la justice. On jouait, sur le théâtre Molière, une pièce où Rohan et Condé, les chefs des émigrés, étaient foudroyés par Robespierre aux applaudissements des spectateurs.
La Législative et la guerre
Les Girondins, à la suite de Brissot, précipitent la Révolution dans la guerre et servent inconsciemment les secrets desseins de la Cour. Robespierre accourt d’Arras pour lutter aux Jacobins contre cette politique imprudente au bout de laquelle il aperçoit la misère et la dictature militaire. Georges Michon vous a dit avec quelle énergie et quelle clairvoyance il essaya de remonter un courant malheureusement irrésistible. Il perça à jour les intrigues et les ambitions des Girondins qui rêvaient, par la guerre, d’imposer au roi des ministres de leur choix. Il dévoila leurs rapports suspects avec Narbonne et avec La Fayette, avec la Cour elle-même. Contre La Fayette, qui restait l’arme au pied à la frontière au lieu d’envahir la Belgique dégarnie de troupes et qui négociait secrètement avec les Autrichiens, il mena, dans son journal Le Défenseur de la Constitution, une campagne admirable. Les Girondins le couvrirent d’injures et de diffamations. Il persista et l’événement le justifia. Quittant brusquement son armée après le 20 juin, La Fayette se présenta à la barre de l’Assemblée pour lui dicter ses ordres et la sommer de dissoudre les Jacobins.
Longtemps, Robespierre avait fait confiance à la Législative. Longtemps, il avait cru que la Constitution de 1791 lui offrait assez de ressources pour briser légalement les complots de la Cour et des généraux. Il avait intitulé son journal Le Défenseur de la Constitution et il avait écrit dans son premier numéro : « Est-ce dans les mots de république et de monarchie que réside la solution du grand problème social ? », voulant signifier par là que ce qui lui importait, c’était moins la forme politique que la réalité démocratique. N’avait-il pas vu des fayettistes notoires, membre du Club aristocratique de 1789, comme le duc du Châtelet, comme Condorcet, faire une bruyante adhésion à la république après Varennes ? Une république, où l’oligarchie bourgeoise aurait gouverné, ne lui paraissait pas préférable à une monarchie populaire pourvue d’institutions sociales.
Mais, au début de juillet 1792, quand il vit que, décidément, l’Assemblée n’osait pas frapper La Fayette ni imposer à la Cour les mesures de salut public qui seules pouvaient sauver la France ; quand il fut bien convaincu que les Girondins ne brandissaient contre le roi que des foudres de carton et qu’ils voulaient seulement l’intimider pour lui imposer le rappel de leurs créatures, les ministres renvoyés le 12 juin, Robespierre, pour couper court à l’intrigue, pour enlever à La Fayette le commandement de son armée et au roi la faculté de continuer ses trahisons, lança aux Jacobins l’idée de la déchéance, et il réclama la convocation d’une Assemblée nouvelle, la Convention, qu’il voulut faire élire au suffrage universel. Par là, dit Jaurès, il témoigna d’un grand sens révolutionnaire.
Ouvertement, il prépara l’insurrection du 10 août. C’est lui qui rédigea l’adresse des Jacobins aux Fédérés accourus des départements. C’est lui encore qui rédigea les pétitions de ces mêmes Fédérés à l’Assemblée pour demander la déchéance du roi. Il harangue les Fédérés et les invite à sauver l’État. La provocation était si flagrante que le ministre de la Justice dénonça Robespierre à l’accusateur public et demanda contre lui des poursuites. Mais l’Incorruptible n’était pas homme à se laisser intimider. Le Directoire secret des Fédérés, qui prépara l’insurrection, se réunissait dans la maison du menuisier Duplay où il logeait lui-même. Pendant que les Girondins, à la veille même de l’insurrection, négociaient encore avec la Cour, pendant que Brissot, le 25 juillet, menaçait, à la tribune de l’Assemblée, les républicains du glaive de la loi ; pendant que Isnard et Brissot demandaient, à la réunion des députés girondins, que Robespierre fût traduit devant la Haute Cour ; pendant que Pétion se rendait chez ce dernier, le 7 août, pour l’inviter à empêcher l’insurrection ; pendant que Danton quittait Paris pour Arcis-sur-Aube et ne rentrait dans la capitale que le 9 août au soir, Robespierre, jour et nuit, restait sur la brèche. La chute de la royauté, la convocation de la Convention, furent son œuvre. Pendant que le canon grondait autour des Tuileries, il s’était tenu près en permanence aux Jacobins, où il prit longuement la parole le jour même du 10 août. Cela n’empêchera pas Vergniaud de l’accuser plus tard de s’être caché dans sa cave ! Calomnie absurde qui a fait son chemin. Vergniaud, lui, avait présidé l’Assemblée et il s’était efforcé de son mieux de sauvegarder les droits de la royauté, et son ami Guadet avait fait décréter la nomination d’un gouverneur au prince royal.
Mais les contemporains savaient le rôle prépondérant que Robespierre avait joué dans ces mémorables événements. Quand la Commune fit frapper une médaille en mémoire du grand jour du 10 août, elle prit un arrêté particulier pour la décerner à Robespierre. Elle ne la décerna pas à Danton, qui était allé, nous dit Lucile Desmoulins, se coucher après que les faubourgs avaient sonné le tocsin.
Faut-il rappeler encore que Robespierre fut l’âme de la célèbre Commune révolutionnaire du 10 août et qu’il dicta en son nom, à la Législative agonisante, les mesures salutaires qui comprimèrent les royalistes et qui repoussèrent l’invasion ? Les électeurs de Paris et du Pas-de-Calais le récompensèrent en l’élisant, le premier de tous leurs députés, à la Convention nationale.
La Convention et la lutte contre la Gironde
Pour mesurer la place que Robespierre a tenue à la Convention, il n’est besoin que d’imaginer par la pensée ce qu’elle serait devenue s’il n’y avait pas siégé. Les Girondins, qui avaient savamment exploité l’horreur excitée dans les provinces par les massacres de septembre, auraient certainement conservé la majorité qu’ils tenaient pendant les premiers temps. Ils s’appuyaient sur les classes riches, ils sonnaient le ralliement de tous les possédants contre la députation de Paris qu’ils représentaient comme composée d’anarchistes. Or, tandis que Danton, dès la première séance, s’empressait de désavouer ses anciens agents de la Commune qui avaient prêché dans les départements après le 10 août la mise en commun des subsistances, tandis qu’il faisait voter par un décret le maintien de toutes les propriétés, Robespierre, ferme et méprisant, supportait seul l’assaut furieux des Girondins qui s’efforçaient par leurs clameurs de lui interdire la tribune. Il prenait la défense de ces commissaires de la Commune du 10 août que Danton avait piteusement répudiés. « Citoyens, s’écriait-il, voulez-vous une Révolution sans révolution ? »
Les Girondins, qui craignaient son immense popularité, l’accusèrent ridiculement, par l’organe du romancier Louvet, d’aspirer à la dictature. Il écrasa l’accusation sous une réplique modeste, spirituelle, précise et ferme. Les Girondins, dans leur légèreté, voulaient sauver Louis XVI tout en ayant l’air de l’accuser. Robespierre perça leur manœuvre. Ses discours admirables dans le procès du roi décidèrent du vote final. Il fit rejeter l’appel au peuple qui eût incendié la République. Dès lors, l’influence des Girondins dans la Convention fut ébranlée et les députés honnêtes et franchement populaires se rangèrent de plus en plus autour du chef de la Montagne. Il était grand temps !
La politique équivoque des Girondins, qui gouvernaient depuis le début de la Convention, avait porté ses fruits. Leur indulgence pour les royalistes, leur faiblesse pour les généraux, leur incapacité administrative, mirent la République en péril au printemps de 1793. Coup sur coup éclatèrent au début de mars la révolte vendéenne et les défaites de Dumouriez en Belgique, bientôt suivies de sa trahison. Dans le désarroi général, Robespierre proposa les mesures de salut public qui sauvèrent la France. Il demanda que les aristocrates dangereux fussent mis en arrestation, qu’une armée révolutionnaire, soldée aux dépens des riches, fût organisée pour exterminer les rebelles et contenir leurs amis, que les fabrications de guerre fussent poussées avec énergie, qu’on établît au besoin des forges sur les places publiques, que le Tribunal révolutionnaire punît les généraux traîtres ou suspects, que les villes et les armées fussent nourries par les réquisitions. Bref, il formula avec netteté et précision le programme du gouvernement révolutionnaire, qu’il fit reposer tout entier sur l’action des prolétaires organisés. « Celui qui n’est pas pour le peuple, celui qui a des culottes dorées est l’ennemi-né de tous les sans-culottes », s’écriait-il dès le 8 mai 1793. Hardiment il proposait aux Jacobins d’abord, à la Convention ensuite, le 24 avril 1793, une nouvelle Déclaration des droits qui contenait en germe, par sa définition de la propriété, la dépossession progressive de la bourgeoisie et l’avènement prochain du 4e État :
1. – La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi.
2. – Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l’obligation de respecter les droits d’autrui.
3. – Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l’existence, ni à la propriété de nos semblables.
4. – Toute possession, tout trafic qui viole ce principe est illicite et immoral.
Il faut entendre Jaurès commenter cette célèbre Déclaration que les socialistes de 1830, après les babouvistes, réimprimeront maintes fois. Si la propriété n’est qu’une institution sociale, comme la définit Robespierre, le droit social passe avant le droit individuel. « La propriété, dans sa formule, n’est que ce qui reste de la propriété quand la société a exercé son droit antérieur et supérieur, quand elle a prélevé ce qui lui est nécessaire pour assurer la vie de tous, quand elle a enlevé à la propriété toutes les pointes par où elle pourrait blesser autrui… Dire que le droit de propriété ne peut préjudicier « ni à la société, ni à la liberté, ni à l’existence, ni à la propriété » des autres hommes, c’est théoriquement, faire du droit de propriété une sorte de suspect contre lequel s’élèvent d’emblée toutes sortes d’hypothèses et de présomptions redoutables, c’est ensuite fonder en droit les vastes expropriations que les modifications de la vie économique peuvent rendre nécessaires plus tard. »
Jaurès a bien vu aussi que Robespierre ne s’était pas livré à une manifestation théorique et vaine, mais qu’il avait voulu enchaîner à la Révolution les petites gens, les artisans et les ouvriers des villes et des campagnes qui souffraient alors affreusement de la cherté de la vie provoquée par la baisse de l’assignat. Sa Déclaration des droits était la justification et l’annonce des mesures sociales qu’il réclamait. Le droit à la vie, le droit au travail, le droit à l’instruction, l’impôt progressif, les réquisitions, c’était là un programme très hardi qui ne fut dépassé ni même atteint par aucun autre conventionnel.
Alors que Danton qui était entré au gouvernement, c’est-à-dire au Comité de Salut public, après la trahison de Dumouriez, semblait atterré par les défaites, alors qu’il ne songeait qu’à conclure une paix rapide, une paix à tout prix avec l’ennemi victorieux, alors qu’il négociait secrètement avec les Autrichiens et les Anglais par l’intermédiaire d’aventuriers comme le belge Proli, alors qu’à l’intérieur il offrait sans cesse aux Girondins le rameau d’olivier et qu’il intriguait avec l’émigré Théodore Lameth exprès revenu de Londres et avec la reine elle-même, Robespierre s’opposait de toute sa force à cette politique pusillanime qui aurait perdu la République et la France. En même temps qu’il faisait voter par la Convention, le 13 avril 1793, une résolution qui interdisait de traiter avec un ennemi qui n’aurait pas reconnu la République, il engageait contre les Girondins la lutte suprême.
Les Girondins, s’étaient opposés à toutes les mesures de salut public, à l’institution des représentants en mission, aux réquisitions et aux taxes, ils empêchaient l’établissement de la dictature révolutionnaire, ils se coalisaient avec les adversaires du régime, il fallait les briser pour rétablir l’unité dans le gouvernement. Robespierre, prenant ses responsabilités comme toujours, prêcha l’insurrection aux Jacobins dès le 27 mai : « Le peuple doit s’insurger. Le moment est arrivé ! » Le 29 mai, il renouvelle son appel aux Jacobins, et le 31 mai, à la Convention, il demande l’arrestation des chefs Girondins qui fut chose faite deux jours plus tard, après le succès de l’insurrection parisienne qui fut son œuvre pour une grande part (4). Et c’est là pourtant l’homme qu’on nous représente comme un trembleur !
Le Comité de Salut public
Après la chute de la Gironde, le grand rôle de Robespierre commence. Il ne tarde pas à entrer au Comité de Salut public, où il remplace avec ses amis Saint-Just et Couthon l’équipe de Danton fatiguée et suspecte. Comme en témoigne son carnet aide-mémoire, que j’ai publié (5), il fut le véritable organisateur du Comité. Il lui traça sa besogne. Il suivit toutes les affaires importantes, même les affaires militaires, mais particulièrement la diplomatie. Il fournit un travail écrasant, car il était en même temps obligé de défendre la politique du Comité devant la Convention et devant les Jacobins. Jaurès a admiré sa vigilance, sa fermeté, son habileté. « Quelle âpre et dure vie, a-t-il écrit, d’aller presque tous les soirs, dans une assemblée populaire souvent houleuse et défiante, rendre compte du travail de la journée, dissiper les préventions, animer les courages, calmer les impatiences, désarmer les calomnies ! Administrer et parler, gouverner sur le forum, associer le peuple à la discipline gouvernementale, quelle terrible tâche ! Mais c’est par là que la sorte de dictature du Comité de Salut public ne tournait pas à une étroitesse de coterie ; c’est par là qu’elle était en communication avec la vie révolutionnaire ! » Et Jaurès n’hésite pas à conclure : « Ici, sous le soleil de juin 93 qui échauffe votre âpre bataille, je suis avec Robespierre et c’est à côté de lui que je vais m’asseoir aux Jacobins, et je suis avec lui parce qu’il a à ce moment toute l’ampleur de la Révolution. »
Robespierre, en effet, accomplit une tâche gigantesque. Sous son impulsion, le Comité vint à bout des révoltes intérieures et de l’invasion. Il vint à bout des faux révolutionnaires qui, à la suite de Danton et d’Hébert, attaquaient sa politique des deux points opposés de l’horizon, les uns par l’arme de la faiblesse, les autres par l’arme de l’exagération. Ici encore j’ai plaisir à me rencontrer avec Jaurès qui approuve Robespierre d’avoir mené résolument la lutte contre les indulgents et contre les extrémistes. Jaurès a bien vu qu’en voulant supprimer la Terreur avant l’heure, avant que la victoire fût acquise, avant que Toulon fût repris aux Anglais, avant que Hoche eût chassé les Autrichiens d’Alsace, avant même que le gouvernement révolutionnaire fût complètement organisé, avant que le maximum fût assuré dans son application, les dantonistes auraient brisé l’effort révolutionnaire et qu’ils recommençaient d’ailleurs le jeu de la Gironde, par leurs éternelles dénonciations contre les meilleurs Montagnards. Il a noté aussi que leur politique de modération hasardeuse et outrancière conduisait à une alliance inévitable avec les monarchistes et il a soupçonné qu’il y avait derrière Danton une intrigue de contre-révolution.
La réalité est plus grave encore. Les documents que j’ai mis au jour et que Jaurès n’a pas connus, prouvent que Danton, qui n’a jamais cessé d’être en relation avec les émigrés et avec les agents de l’ennemi était leur suprême espoir. Il essaya de faire évader la reine. Il tenta d’extorquer à Pitt 4 millions pour sauver Louis XVI. Sa fortune s’accrut dans des proportions scandaleuses. Après sa sortie du Comité de Salut public, il mena une campagne sourde pour une amnistie générale, pour une paix à tout prix et pour la rentrée des émigrés. Ses amis essayèrent, à plusieurs reprises, de renverser le Comité de Salut public, le 25 septembre, le 22 frimaire (12 déc. 93). Homme de plaisir et d’argent, il fut compromis avec ses amis Chabot, Fabre d’Églantine, Basire, dans de louches affaires financières dont la plus connue est celle de la liquidation de la Compagnie des Indes. Sa campagne pour la clémence était inspirée par son intérêt personnel. Il voulait briser les échafauds, comme Hébert, parce qu’il craignait d’y monter. Si son complot avait réussi, la restauration de la monarchie eût été avancée de 18 ans. Les révolutionnaires sincères eussent été conduits à l’échafaud quelques mois avant thermidor et les pillards eussent mis à l’abri leurs rapines.
Quant aux hébertistes, si la plupart étaient des révolutionnaires sincères et honnêtes, qui avaient rendu de grands services, ils comptaient pourtant parmi eux plus d’une brebis galeuse, des étrangers suspects, sujets ennemis, qui, en poussant aux excès, faisaient le jeu des rois coalisés, tels Proli, tels les Frey, tels l’espagnol Guzman, le saxon Saiffert. Les hébertistes, Jaurès l’a bien vu, étaient les militaristes et les impérialistes de l’époque.
Ronsin, leur chef, ancien acteur, était général de l’armée révolutionnaire. Ses partisans étaient nombreux dans les bureaux de la guerre. Ils faisaient sonner leurs grands sabres et professaient pour les civils de la Convention et des Comités un mépris profond, le mépris du militaire pour le pékin. Ils ne voyaient aux difficultés de l’heure qu’un remède : la violence. Ils ne parlaient que de mitrailler et de guillotiner. Installés dans la guerre, qui leur avait valu les places et les honneurs, ils n’étaient pas pressés de la voir finir. Anacharsis Cloots, en leur nom, demandait l’annexion de la Hollande, de la Belgique, du pays rhénan. Il adjurait les Français de ne pas déposer les armes avant d’avoir abattu tous les trônes et établi la République universelle.
Enfin, par leurs violences contre le culte, par la fermeture brutale des églises, ils risquaient de soulever contre la Révolution les masses restées très pieuses et de multiplier la Vendée.
Robespierre, qui n’était pas croyant, qui ne pratiquait pas, même au collège, mais qui professait pour l’âme simple du peuple un respect profond et délicat, Robespierre, qui craignait que les folies déchristianisatrices n’étendissent la guerre civile à tout le territoire et n’achevassent de nous aliéner les dernières sympathies des peuples étrangers, s’opposa avec un beau courage aux violences de l’impérialisme hébertiste comme aux faiblesses équivoques des Indulgents. Il n’est pas vrai qu’il ait opposé avec machiavélisme les hébertistes aux dantonistes et qu’il ait détruit les uns par les autres. Bien au contraire ! Il lutta de front contre le double péril, en toute clarté. Et, ici encore, Jaurès lui a rendu justice.
Robespierre ne voulait pas de la paix de défaite, de la paix royaliste des dantonistes, et il ne voulait pas davantage de la guerre impérialiste des hébertistes. Il a écrit dans ses notes intimes cette phrase révélatrice que Jaurès a soulignée, et qui n’a rien perdu de son actualité : « Il faut armer non pour aller au Rhin, c’est la guerre éternelle, mais afin de dicter la paix, la paix sans conquêtes. » Cela n’a pas cessé d’être la sagesse.
Il répugnait au terrorisme sanguinaire. Il avait proposé l’abolition de la peine de mort sous la Constituante. Il n’avait accepté la Terreur, la suspension des libertés, que contraint et forcé par les événements. Toujours il s’opposa aux représailles inutiles. Il sauva, au prix de sa popularité, les 73 Girondins qui avaient protesté contre le 31 mai. Il voulut sauver le constituant Thouret, Mme Élisabeth, sœur de Louis XVI ; il sauva les signataires des pétitions royalistes des 8000 et des 20 000, et bien d’autres. Il voulait limiter la répression au strict nécessaire. Il s’efforça longtemps de calmer, par la persuasion, l’opposition des dantonistes et des hébertistes coalisés. Mais les uns et les autres restèrent sourds à ses invitations. Les hébertistes voulurent recourir à l’insurrection. Ils préparaient une sorte de coup d’État populaire et militaire, un 18 brumaire démagogique qui aurait fait de la France une Pologne de septembriseurs, a dit Jaurès. Les dantonistes, de leur côté, complotaient. Alors Robespierre se résigna à mettre en marche l’appareil de la justice politique. Les terroristes qui l’abattirent en thermidor lui reprochèrent ses lenteurs, ses hésitations à abandonner Danton.
Thermidor
Les factions abattues, en germinal an II (mars-avr. 94), Robespierre n’eut plus qu’une pensée : réconcilier les masses avec le régime, afin d’assurer son avenir. Il fit supprimer l’armée révolutionnaire qui épouvantait les cultivateurs et les marchands. Il fit rappeler des départements les proconsuls qui, selon son expression, avaient déshonoré la Terreur par leurs brigandages et leurs folies. Il fit mettre la vertu, c’est-à-dire l’honnêteté à l’ordre du jour. Il organisa cette fête de l’Être suprême que les Français considérèrent comme la répudiation des violences hébertistes et l’annonce de la fin prochaine de la Terreur. Mais, en même temps, il fit voter cette loi de prairial qui était destinée, dans son esprit, à frapper uniquement quatre ou cinq proconsuls sanguinaires et corrompus, afin de montrer au peuple, par un exemple retentissant, que ses représentants qui avaient abusé de la toute-puissance nationale n’étaient pas au-dessus de la justice révolutionnaire.
Jaurès ne doute pas que la loi de prairial et la fête de l’Être suprême, dans la pensée de Robespierre, n’aient été la préface de l’amnistie qu’il rêvait pour mettre fin au régime d’exception, maintenant que nos armées victorieuses avançaient dans les pays ennemis. Mais il lui a reproché de n’avoir pas dit nettement au peuple français le noble but qu’il poursuivait. Il croit que si Robespierre avait hautement proposé l’amnistie, il aurait été compris, car jamais sa popularité n’avait été plus grande. C’est possible, mais je ne puis suivre Jaurès quand il dit ensuite que Robespierre a imposé sa loi au Comité de Salut public. La vérité est tout autre. La loi de prairial ne fit qu’étendre au Tribunal révolutionnaire de Paris les dispositions déjà arrêtées un mois auparavant pour la commission d’Orange, chargée de punir les contre-révolutionnaires du Vaucluse. Le Comité de Salut public et plus encore le Comité de Sûreté générale, dans leur grande majorité, étaient hostiles à la cessation de la Terreur. Et c’est justement leur hostilité qui a empêché Robespierre d’annoncer tout haut son but véritable. Et, ce qui le prouve, c’est que la loi de prairial, au lieu de fonctionner contre les seuls proconsuls corrompus, aboutit aux hécatombes de la Grande Terreur, auxquelles Robespierre resta complètement étranger, puisqu’il cessa de participer aux travaux du Comité dès qu’il y fut en minorité, et puisque sa signature manque désormais à ses arrêtés. Une des dernières fois qu’il y parut, le 8 messidor (26 juin 94), ce fut pour arracher à Fouquier-Tinville la vieille Catherine Théot, une pauvre illuminée que Vadier voulait livrer au Tribunal révolutionnaire. Bien loin que Fouquier-Tinville eût été son instrument, comme on le répète, il était son ennemi, à tel point que Robespierre, ainsi que je l’ai démontré, avait demandé sa révocation et son remplacement au Comité de Salut public, à cette même séance du 8 messidor ! Le Comité maintint Fouquier en fonction et se solidarisa avec lui, et par là il porte la responsabilité de la Grande Terreur.
Les historiens qui font de Robespierre un dictateur et un pontife et qui placent sa dictature et son pontificat après la fête de l’Être suprême et la loi de prairial, se moquent de la vérité et du bon sens. C’est précisément à ce moment que le prétendu dictateur fut mis en minorité au gouvernement et qu’il perdit toute influence sur les affaires.
Sa retraite fut une faute. Elle laissa le champ libre aux terroristes ses ennemis. Les hideux proconsuls qu’il avait fait rappeler, les Tallien, les Fouché, les Barras, les Rovère, les Carrier, les Legendre, les Merlin de Thionville, les Reubell, les Courtois, les Thibaudeau, les Bourdon, les Guffroy, eurent le temps de se concerter, d’épouvanter leurs collègues et de préparer dans l’ombre le coup du 9 thermidor (27 juil. 94). Mais Robespierre, dont la santé avait été ébranlée par les veilles et les fatigues, à tel point qu’il avait dû garder la chambre à la fin de l’hiver pendant tout un mois, Robespierre, qui avait fait d’avance le sacrifice de sa vie dès le jour radieux de sa jeunesse où il s’était entretenu avec Jean-Jacques, Robespierre était hanté par l’idée de la mort. Le spectacle de l’échafaud, où Fouquier-Tinville entassait pêle-mêle les victimes, bouleversait son âme candide. Il était maintenant comme paralysé devant l’immensité de la tâche qui s’offrait à son courage épuisé par cinq années de luttes terribles.
Il chercha un refuge aux Jacobins. Il protesta devant eux, avec l’accent du désespoir, contre les calomnies qui le représentaient comme un tyran qui voulait égorger la Convention. Il leur répéta, le 23 messidor (11 juil. 94), que ses principes étaient, au contraire, « d’arrêter l’effusion du sang humain versé par le crime ».
Quand il se décida enfin, le 8 thermidor (26 juil. 94), après un mois d’hésitations, à s’expliquer devant la Convention, il était trop tard. La calomnie avait fait son chemin. D’ailleurs, Robespierre s’exprima dans son discours moins comme un tribun qui attaque que comme un juste qui s’offre au martyre. Il présenta lui-même son discours comme un testament de mort. Ses hésitations le lendemain à prendre la direction de l’émeute contre la Convention, le coup de pistolet par lequel il essaya de terminer sa vie quand l’Hôtel de Ville fut forcé par les troupes de Barras, tout prouve qu’il était las de la lutte et qu’il aspirait au repos de la tombe.
Il a succombé sous les coups des fripons qui ont rejeté sur leur victime leurs propres crimes. Ces fripons ne songeaient nullement alors à arrêter la Terreur. Bien au contraire ! Fouché s’écriait, le 19 fructidor (5 sept. 94) : « Toute pensée d’indulgence est une pensée contre-révolutionnaire. » À la séance même du 9 thermidor, Billaud-Varenne reprocha à Robespierre son indulgence et rappela qu’il avait longtemps défendu Danton. Barère enfin, le 11 thermidor (29 juil. 94), prononça un éloge sans réserve du Tribunal révolutionnaire, « cette institution salutaire qui détruit les ennemis de la République et purge le sol de la liberté ».
En apprenant l’arrestation de Robespierre, les détenus dans les prisons craignirent d’abord une aggravation de la Terreur. L’un d’eux, le royaliste Beaulieu, nous le dit : « Uniquement occupés dans nos prisons, à rechercher dans les discours qu’on prononçait, soit aux Jacobins, soit à la Convention, quels étaient les hommes qui nous laissaient quelque espoir, nous y voyions que tout ce qu’on disait était désolant, mais que Robespierre paraissait encore le moins outré. »
Le 9 thermidor – c’est la vérité historique – ne fut pas fait par des hommes qui voulaient arrêter la Terreur, mais, au contraire, par des hommes qui avaient abusé de la Terreur et qui voulaient la prolonger à leur profit pour se mettre à l’abri. Parce que ces hommes furent débordés après l’événement, parce qu’ils ne parvinrent pas à retenir la réaction qu’ils avaient involontairement déchaînée en identifiant, pour des raisons de tactique, Robespierre avec les excès, la légende s’est formée que Robespierre avait été vraiment la Terreur personnifiée. L’Incorruptible est devenu après sa mort le bouc émissaire de la Révolution.
La place de Robespierre dans l’histoire
Il serait temps enfin, citoyens, de rendre justice à ce grand homme dont la vie fut un perpétuel sacrifice au bien public et dont la chute ébranla la République jusqu’à la base et laissa désormais la voie libre aux profiteurs et, derrière eux, aux généraux et à Bonaparte. Les Conventionnels, même les plus médiocres, ont aujourd’hui leurs statues. Leurs noms sont gravés sur les plaques des rues. Seul Robespierre reste un réprouvé. Celui qui fut jusqu’au dernier souffle le défenseur ardent et convaincu des travailleurs ; celui dont la vie privée comme la vie publique furent transfigurées par les plus hautes vertus ; celui qui a illustré la tribune française par une éloquence qui atteint parfois le sublime ; celui dont les vainqueurs eux-mêmes, les Cambon, les Barère, les Barras, regrettèrent plus tard la défaite comme une calamité nationale ; celui dont les écrits et l’exemple inspirèrent par-delà le tombeau tous les démocrates et tous les socialistes de la première partie du XIXe siècle, ceux de l’étranger comme ceux de France ; celui que la vigoureuse génération républicaine de 1830, instruite par Buonarroti et les derniers survivants de la Montagne, adora comme la parfaite incarnation de la démocratie sociale ; celui que la jeune Allemagne de Bœrne et de Gutzkow, que la jeune Italie de Mazzini et de Garibaldi et le chartisme anglais d’O’Connor et d’O’Brien adoptèrent comme un porte-drapeau ; celui que Georges Sand, avant Anatole France, proclamait « le plus grand homme de la Révolution et l’un des plus grands de l’histoire », celui qui inspira les révolutionnaires de 1848 et ceux de la Commune ; celui que les révolutionnaires russes d’aujourd’hui, plus soucieux de nos gloires que nous-mêmes, honorent comme un ancêtre et comme un précurseur ; celui dont Lénine, qui lui ressemble à bien des égards, a dressé l’effigie devant le Kremlin ; le profond politique dont la clairvoyance égala le courage et le désintéressement, Robespierre, enfin, est aujourd’hui presque inconnu, quand il n’est pas méconnu de cette foule qui devrait pourtant garder pieusement sa mémoire, puisque c’est pour son affranchissement et pour son bonheur qu’il a vécu et qu’il est mort.
Voilà quatorze ans bientôt, citoyens, qu’une petite phalange d’érudits et de chercheurs, groupés dans la Société des études robespierristes, se sont attachés à faire cesser un injuste ostracisme. Contre les légendes, et les mensonges, et les calomnies, ils se sont levés, n’ayant pour tout appui que la vérité. Déjà les fumées se dissipent. La lumière se fait et la victoire est proche. « Réveiller Robespierre, disait le grand Babeuf, au moment où il se lança dans la bataille contre les pourris du Directoire, c’est réveiller la démocratie, et ces deux mots sont parfaitement identiques ! »
Citoyens, nous avons entendu l’appel de Babeuf, nous avons réveillé Robespierre. Nous ne l’aurons pas fait en vain, pour peu que les démocrates, les socialistes et les communistes d’aujourd’hui ne ferment pas l’oreille à l’évidence et comprennent leur devoir comme leur intérêt. Votre présence à ces conférences nous est un encouragement précieux. Je vous en remercie. Mais nous avons besoin d’autre chose que d’encouragements platoniques. La guerre a arrêté l’édition que nous avons commencée des œuvres complètes de Robespierre. Nous ne pouvons pas compter, bien entendu, sur le secours des Académies, ni des représentants du Bloc national. Nous faisons appel à tous les fervents de la Révolution, à toutes les consciences libres et droites, à tous les hommes d’avenir et de progrès, à tous les amateurs d’histoire, pour qu’ils nous donnent leur adhésion, pour qu’ils souscrivent à nos publications, pour qu’ils nous aident à vaincre les mensonges bourgeois et thermidoriens. Ils prépareront ainsi l’avènement de la cité juste et fraternelle.
Notes :
(1) Entre autres dans mes Études robespierristes (2 vol.) ; Danton et la Paix (1 vol.) ; L’Affaire de la compagnie des Indes (1 vol.) ; Robespierre terroriste (1 vol.) ; La Révolution et les Étrangers (1 vol.).
(2) Réfugié à Mannheim, il ne revint à Arras qu’une seule fois, pour y régler une succession et repartit aussitôt.
(3) Au club des Jacobins. N.D.E.
(4) En fait, Robespierre n’a pas demandé l’arrestation des chefs girondins, mais la révocation de ces députés pour avoir perdu la confiance de leurs électeurs. Il s’agit du système électoral du mandataire révocable que le peuple pratiquait depuis le Moyen-âge et que la constitution de 1791 avait supprimé, mais qui fut rétabli depuis la Révolution du 10 août 1792 pour élire la Convention. N.D.E.
(5) Voir dans le présent recueil l’article « Le carnet de Robespierre ». N.D.E.

