Une part égale de liberté. La Révolution américaine et le patriotisme anglais Annonces
samedi 4 février 2017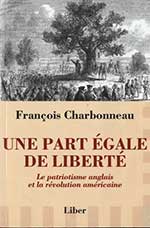
Introduction de l'ouvrage de François Charbonneau, Une part égale de liberté. La Révolution américaine et le patriotisme anglais, Montréal, Liber, 2013.
François Charbonneau est enseignant à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa et spécialiste des idées politiques aux États-Unis et au Canada. Dans cet ouvrage, il s’intéresse à la période de la crise impériale et du début de la Révolution américaine, entre 1763 et le moment de la rédaction des constitutions des états d’Amérique du Nord dans les années 1775-1780.
L'auteur part de la constatation d’un paradoxe apparent : jusqu’à la publication du Common Sense de Thomas Paine en 1776, l’immense majorité des acteurs politiques des treize colonies britanniques d’Amérique du Nord refusent l’idée d’indépendance et cherchent au contraire à rester dans la dépendance de l’Empire britannique. Tous les Américains ne parlent que de liberté, entendue comme une non-dépendance, mais dans le même temps, ils revendiquent une forme de dépendance assumée à l’égard de l’Angleterre et de son roi (au moins jusqu’aux premiers combats de Lexington et Concord en 1775). La solution de ce paradoxe se situe selon l’auteur dans le fait que les Américains se sentaient totalement partie prenante de ce qu’était la nation anglaise ou plutôt le corps politique britannique, alors défini comme le "plus libre du monde". La liberté ou les libertés anglaises fondaient une forme de patriotisme anglais revendiqué intégralement par les Américains. La véritable question que posent les Américains à l’Angleterre pendant la crise impériale n’est donc pas seulement fiscale ou économique (sans négliger ces aspects, l’ouvrage ne les traite pas) mais elle est peut-être avant tout identitaire et politique. "Ne sommes-nous pas Anglais ?" semblent demander les Américains au gouvernement britannique tout au long de la crise impériale.
INTRODUCTION
Le 19 mai 1774, la petite ville de Farmington, dans le Connecticut, est fébrile. La nouvelle de l’adoption de la loi du port de Boston, le Boston Port Act, se répand comme une traînée de poudre. En réaction à la fameuse « partie de thé », le Parlement britannique avait en effet décidé quelques semaines plus tôt de fermer le port à la navigation. Immédiatement frappés de consternation devant l’apparente démesure des représailles imposées au plus important port maritime de la Nouvelle-Angleterre, les notables de Farmington décidèrent donc de tenir une assemblée publique extraordinaire. Il faut imaginer la scène : à l’appel du tocsin des églises, tout ce que la ville comptait d’habitants se précipite alors à ce town meeting impromptu. Pour manifester leur solidarité avec les Bostoniens, les habitants de Farmington adoptèrent un certain nombre de résolutions que l’on s’empressa d’afficher aux quatre coins de la ville. La première stipule que le soir même, à 18 h, se tiendrait rien de moins que le procès de la loi, formellement accusée « d’avoir violé les libertés de l’Amérique ».
Ce n’est pas pour en connaître les résultats que près d’un millier de villageois et de fermiers des campagnes environnantes assisteront au procès le soir venu. En effet, non seulement la résolution adoptée l’après-midi même comporte l’acte d’accusation, mais l’on y annonce également d’un même trait le verdict ! Au terme du procès, peut-on lire sur le placard, sera « passé au feu, en l’honneur de l’immortelle déesse de la liberté, la dernière loi infâme du Parlement britannique ». Tous les « fils de la liberté » sont conviés à assister à l’autodafé. Pour marquer l’occasion, on plantera un « poteau de la liberté » de quarante-cinq pieds et des toasts seront portés « à la gloire et à la défense des libertés anglaises ».
Le procès étant sans appel, la justice eut cours tel que prévu dans une ambiance de solennité affectée. À son terme, les habitants de cette commune élaborèrent d’autres résolutions, cette fois afin de les acheminer à l’assemblée législative de la colonie. On peut y lire que « le présent cabinet, inspiré par le Diable et mené par des coeurs haineux et corrompus, cherche à nous enlever nos libertés et propriétés et à nous réduire en esclavage à jamais ». Or, il est bon « que l’on sache que nous méprisons les chaînes de l’esclavage, et que nous méprisons toute tentative de nous les passer ; nous sommes les fils de la liberté, et nous sommes déterminés à ce qu’une divine vertu résonne dans notre hémisphère jusqu’à la fin des temps». Après l’adoption de ces résolutions, les effigies des « complices » américains du cabinet anglais furent offertes à la justice expiatoire du feu, notamment celle du gouverneur Hutchinson du Massachusetts. Au terme de la parodie, les habitants se dispersèrent dans la bonne humeur.
Au cours de la période de tumultes qui précède ce que la postérité nommera la guerre d’indépendance (1775-1782), c’est-à-dire de 1763 (alors que les premières rumeurs sur d’éventuelles taxes sur le sucre à destination des colonies américaines commencent à circuler) jusqu’à la veille des batailles de Lexington et Concord en avril 1775, des attroupements autour des « arbres de la liberté », des town meetings, des processions publiques, se sont tenus partout dans les colonies, en tous points similaires au « procès » de Farmington. Les enjeux pouvaient considérablement varier. Des milliers d’attroupements du même type eurent lieu contre la tenure du salaire des juges au Massachusetts, contre la dissolution de l’assemblée législative new-yorkaise, contre l’obligation de payer pour le cantonnement des troupes, contre la présence du Gaspée, navire de la Royal Navy, au Rhode Island, contre le refus londonien de permettre l’impression de papier monnaie dans les colonies, contre les Townshend Duties et les diverses lois intolérables dans toutes les villes d’Amérique, contre l’établissement d’un épiscopat anglican sur le sol américain, contre la domination économique des villes côtières dans les villages situés près des frontières occidentales, et contre bien d’autres choses encore. La nature éclectique et même contradictoire des revendications pourrait nous faire manquer ce qu’une analyse même superficielle révèle aisément. Chaque fois, dans chacune de ces manifestations, il y a un thème qui prédomine ; tous les enjeux circonstanciels peuvent en effet se ramener, dans l’esprit des participants eux-mêmes, à une préoccupation dominante : la liberté. À la veille de la révolution, tous les enjeux politiques et économiques se résumaient à une question, éternellement répétée : « Serons-nous libres ou serons-nous esclaves ? »
Rester libre. Pas un pamphlet, pas un sermon, pas un article de journal ne dit jamais autre chose. Mais une lecture des écrits de l’époque permet facilement de constater que les Américains ne s’expliquaient pas la liberté exactement de la même manière que nous le faisons aujourd’hui. Non pas que cette réflexion nous soit devenue étrangère — ses principaux thèmes, comme l’autonomie de la volonté, la liberté religieuse ou encore la liberté de conscience sont encore les nôtres. Il faut plutôt voir que la conception de la liberté que partagent les Américains avec l’ensemble du monde anglo-saxon du dix-huitième siècle trouve sa source dans l’idée maîtresse qu’est l’absence de dépendance. Être libre, c’est d’abord et avant tout ne pas dépendre de la volonté de quelqu’un d’autre. La compréhension anglo-saxonne du politique jusqu’à l’indépendance américaine procède de cette idée, dont l’importance dépasse les questions strictement politiques. Pour l’homme qui aspire à mener une vie bonne, la liberté consiste à ne pas dépendre de ses passions en agissant selon les préceptes de la raison et de la loi, idée si importante en ce siècle des Lumières. Pour l’immigrant européen qui a traversé les mers pour gagner l’Amérique, c’est le moment où se terminent ses années de « servitude volontaire ». Pour le noble anglais ou le gentleman américain, elle signifie qu’on possède suffisamment de terres pour s’assurer d’une autonomie permettant de vaquer aux affaires publiques. Pour les nations, cette fois, la liberté consiste à ne pas dépendre de la volonté d’un tiers, qu’il s’agisse d’un monarque étranger ou même autochtone.
La liberté définie comme absence de dépendance est la pierre angulaire de la compréhension anglaise du fonctionnement des institutions politiques au dix-huitième siècle. Chaque fois que, avant 1776, les colonies américaines se sont opposées à des mesures ( le plus souvent, mais pas exclusivement, fiscales ) du Parlement londonien, elles ont justifié leur opposition en affirmant que la mise en vigueur de ces lois constituerait un déni de liberté et les placerait en état d’esclavage — rien de moins. L’affirmation peut aujourd’hui nous sembler démesurée, surtout provenant de la bouche d’individus qui possédaient souvent eux-mêmes de véritables esclaves d’origine africaine. Elle est pourtant à entendre en son sens le plus strict : à l’époque, il existe deux figures types de l’être humain, l’homme libre et l’esclave. Ce qui les distingue ne tient pas principalement à l’abjection des conditions de vie du second, ni à son statut d’objet ou de propriété, non plus au fait que l’esclave doit souvent endurer des peines physiques reliées à la lourdeur des tâches qui lui sont imposées par un tiers. Non, ce qui distingue l’homme libre de l’esclave est d’abord que ce dernier dépend de la volonté d’un autre homme. Selon cette définition, les Anglais jugeaient que la plupart des nations étaient dans un état d’esclavage. Pour eux, le Français ou l’Espagnol soumis à un monarque absolutiste n’étaient pas moins en situation de servitude que l’esclave africain.
Du début jusqu’à la fin de la crise impériale, les Anglais d’Amérique mobiliseront cette conception de la liberté. Tracts, pamphlets, sermons commencent presque invariablement par une brève explicitation de ce qui constitue la différence entre un homme libre et un esclave. Or, si les patriotes comprendront leurs actions pendant la révolution comme une lutte pour la liberté, au sens que nous venons de dire, ils n’auront de cesse de rejeter catégoriquement toute velléité collective d’indépendance, au moins jusqu’à la fin de 1775, et dans certains cas — pensons aux très nombreux loyalistes — même après la déclaration d’indépendance. Bien au contraire, ils réitéreront à satiété leur volonté de maintenir leur « état de dépendance » à l’égard de la couronne britannique. Le roi d’Angleterre gardera son lustre auprès des colons américains au moins jusqu’à la publication en janvier 1776 du Common Sense de Thomas Paine, et cela malgré les preuves que George III non seulement approuvait, mais désirait que le Parlement anglais affirme sa souveraineté contre les prétentions des colonies, en toutes choses fiscales et législatives.
Les patriotes américains emploient très explicitement l’expression « maintenir notre dépendance » pour décrire la nature du rapport qu’ils souhaitaient préserver avec la Grande-Bretagne. Un lecteur sceptique pourrait penser que nous faisons grand cas du mot « dépendance », qui pourrait sans doute être remplacé par celui de « lien ». Nous verrons pourtant que les Américains voyaient bien ce lien au sens propre du mot dépendre. Il y va de leur compréhension de la nature du corps politique, ce que nous appelons aujourd’hui l’État. Le corps politique, comme le corps humain, possédait une seule tête ainsi qu’un ensemble de membres aux fonctions distinctes et complémentaires. À la fin de la guerre de Sept Ans, et pendant de nombreuses années encore, les Américains savent que, économiquement, ils remplissent une fonction particulière dans l’empire, et ils acceptent généralement (malgré certaines critiques et le fait massif de la contrebande) cette subordination nécessaire. Mais ils reconnaissent aussi la nécessité, pour eux, d’être, en dernière analyse, dépendants des institutions politiques anglaises, puisque chaque corps politique, dans leur compréhension des choses, ne doit compter qu’une seule tête. Les lettres, pamphlets et pétitions de 1765 reconnaissent d’emblée la suprématie parlementaire, que les Américains jugent jusque-là compatible avec leurs libertés. Évidemment, la crise impériale — suscitée entre autres par ceci que les Américains interprètent les agissements du Parlement comme des tentatives de leur retirer cette liberté qu’ils tiennent le plus grand bien — s’apprête à bouleverser cette compréhension du rapport des colons américains à la mère patrie. Comprise en ce sens, la crise impériale est un test de cette dépendance et, avec elle, de la compréhension anglo-saxonne du politique. En somme, d’un côté, les révolutionnaires américains partagent une compréhension anglo-saxonne du monde qui accorde à la liberté la valeur cardinale. Dans l’articulation de la défense des colonies, c’est cette conception de la liberté qui est mise en avant, et c’est pour la défendre que nombre d’Américains seront prêts à mettre en jeu « leur vie, leur fortune et leur honneur le plus sacré ». On ne comprend pas le droit des Anglais, le fonctionnement du régime politique anglais, la pratique politique anglaise, si on oublie que tout cela est porté par une compréhension de la liberté comme absence de dépendance. C’est le sens même du mouvement patriote. De l’autre côté, pourtant, les Américains affirment ne souhaiter qu’une chose, demeurer collectivement et explicitement dépendants de la Grande- Bretagne et assujettis à la couronne britannique. Ils pouvaient ainsi affirmer dans la même phrase, comme si tout cela allait de soi, que la liberté était incompatible avec la dépendance et que la soumission au bon plaisir du monarque anglais était leur souhait le plus cher. Nous nous emploierons à saisir ce paradoxe, dont il faut rappeler qu’il n’en était pas vraiment un pour les acteurs coloniaux de l’époque. Si une infime minorité s’avisera de l’étrangeté de réclamer à la fois la liberté et la dépendance, ce n’est que lorsque la rupture paraîtra inévitable qu’une majorité d’Américains viendra à conclure à l’incompatibilité entre ces deux objectifs. Et ce n’est qu’à quelques mois de l’indépendance qu’on a pu décrire brutalement la nature antinomique des revendications américaines.
À retracer le fil des évènements, on perçoit aisément une scission entre les Américains qui se portent à la défense des droits des colonies. Il y a, bien sûr, ceux qui demeurent loyaux jusqu’au bout et qui se méfient des conséquences néfastes de l’indépendance. Mais pour la majorité des patriotes qui appuient et défendent — après l’avoir si longtemps combattue — l’idée d’indépendance, on constate qu’ils aperçoivent à peu près tous au même moment, d’une colonie à l’autre, les tenants et aboutissants de la conception de la liberté qu’ils brandissaient pourtant depuis le début du conflit impérial. Ce qui apparaissait la veille comme allant de soi semblera le lendemain comme une proposition incongrue. Comme l’écrit avec candeur un New-Yorkais à l’été 1775 : « Tous les hommes bons souhaitent que l’Amérique puisse demeurer libre : moi le premier ; en même temps, je ne désire pas qu’elle soit totalement indépendante de la mère patrie. Comment réconcilier ces deux principes discordant, j’admets être totalement perplexe. » On en viendra littéralement à ne plus savoir comment réconcilier liberté et état de dépendance sous la Grande-Bretagne, alors qu’au début du conflit c’est précisément l’inverse que l’on aurait été incapable d’envisager.
Comment expliquer que les Américains ne se soient avisés de la contradiction de leurs revendications que très tard dans le conflit ? La clé de la réponse est dans le patriotisme anglais. À nos yeux, en effet, il ne fait pas de doute que leur combat jusqu’à la veille de l’indépendance se présente globalement comme une quête d’égale liberté animée par ce patriotisme, qui est à l’époque d’une nature particulière. On tient que les Anglais forment un peuple qui se distingue des autres précisément parce qu’il connaît les conditions nécessaires à la liberté, la principale étant celle-ci : les peuples libres sont les peuples jaloux de leurs libertés et prêts à les défendre l’arme au poing. Les Américains se croient à cet égard plus Anglais que les Anglais. Ils ressassent ainsi, inlassablement, un discours sur l’unicité de la nation anglaise, sur ses vertus et qualités particulières, sur la grandeur et l’originalité de son système politique et de son histoire. Selon ce discours, véritable mythologie nationale, le génie de la nation anglaise serait d’avoir réussi à créer un espace politique où règne la liberté, là où les autres nations du monde ont lamentablement échoué.
Mais les Anglais ne s’expliquent pas leur liberté comme une caractéristique innée. S’il est vrai qu’ils remercient Dieu et leurs ancêtres de leur avoir « donné » la liberté, ils retiennent de l’histoire de l’Angleterre que la liberté est le fruit de la vigilance du peuple, de sa vertu, d’hommes désintéressés qui aiment leur pays et qui surveillent leurs concitoyens corrompus toujours prêts à asservir leurs semblables. L’histoire anglaise est comprise comme l’histoire d’un peuple aux aguets devant les inévitables effets corrupteurs du pouvoir. Au dix-huitième siècle, pour les Anglais des deux côtés de l’Atlantique, le pouvoir est la principale menace contre la liberté. La réflexion sur le corps politique demeure largement manichéenne. Il est libre si l’exercice du pouvoir a comme objectif de protéger les libertés de la nation, il est esclave si, au contraire, tous sont soumis à la volonté de l’Un. Mais, à lui seul, le pouvoir ne saurait se soumettre tout un peuple. On juge en effet que les peuples ont le régime politique qu’ils méritent. Si, de tous les peuples, seul le peuple anglais vit dans un régime politique libre, c’est que lui seul est demeuré vertueux et sur ses gardes face aux tentatives d’usurpation du pouvoir.
En somme, la liberté pour les Anglais d’Amérique en 1763 est pleinement politique, tout entière contenue dans les frontières de la nation. Elle est un héritage précieux et fragile, l’oeuvre de l’histoire, le fruit de l’action et de la sagesse des générations. C’est parce que les Américains se sentent membres à part égale de cette nation si glorieuse, si libre, que l’état de dépendance envers la Grande-Bretagne n’apparaît pas comme une contradiction avec l’idée même que la liberté consiste pourtant pour eux en l’absence de dépendance. Ainsi, lors du conflit impérial, le refus de l’indépendance ne s’est pas réduit, comme on l’a trop souvent affirmé, à des considérations de faisabilité économique ou à des rivalités coloniales. L’indépendance, dans le contexte des colonies américaines, est d’abord un problème éminemment politique ; elle pose le problème classique de l’expatriation et du déracinement, comme l’illustre si élégamment John Dickinson en 1768 : « Mais si nous sommes une fois séparés de notre Mère-Patrie, quelle nouvelle forme de Gouvernement adopterons-nous ? & où trouverons-nous une autre Grande Bretagne pour suppléer notre perte ? arrachés du corps auquel nous sommes unis par la Religion, par la liberté, par les loix, par l’affection, par la parenté, par le langage & par le Commerce, nous saignerions de toutes nos veines. »
Si l’indépendance est le contraire de ce qui est recherché par les Américains, la logique du patriotisme anglais qui les somme de se montrer aux aguets devant les menaces contre leurs libertés les poussera toujours davantage vers une radicalisation de leur opposition. Cela les mènera presque malgré eux à s’arracher du corps qui avait jusque-là garanti leur liberté. Nous nous intéresserons dans ce qui suit à ce passage et à ses conséquences sur la compréhension américaine du politique. Le lecteur y découvrira que les principales crises qui marquent la fin de la période coloniale américaine travailleront puissamment certains présupposés de la pensée politique anglo-saxonne en sol d’Amérique. Nous faisons donc nôtre l’heureuse formule de Bernard Bailyn selon laquelle le conflit impérial a permis aux acteurs américains de préciser leurs assises idéologiques, et de découvrir au coeur de l’action la « logique de leur propre opposition ».
Ce livre est divisé en trois parties. La première présente les enjeux philosophiques et politiques du conflit impérial, principalement dans la perspective des colons d’Amérique. La deuxième s’intéresse plus spécifiquement à l’approfondissement de la crise impériale entre 1767 et 1775 et aux tentatives malaisées de concilier liberté et dépendance. La dernière montre comment le livre Le sens commun de Thomas Paine tranche le noeud gordien de l’indécision américaine en transformant en simples « préjugés » délétères l’admiration que les Américains portent à la constitution anglaise. Sera enfin question des effets du combat des révolutionnaires américains sur la reconnaissance de leur droit égal de jouir du droit des Anglais lorsqu’ils écriront leurs propres constitutions étatiques entre 1775 et 1780.
Nous démontrerons que l’accent mis dans presque toutes les constitutions étatiques, et dans la déclaration d’indépendance elle-même, sur l’idée d’égale liberté n’est nullement étranger aux paramètres centraux de la crise. Les commentateurs ont souvent affirmé que les Américains ont adopté une philosophie du droit naturel au moment de rédiger leurs constitutions, là où, au début de la crise, ils auraient plutôt misé sur une défense « constitutionnelle » de leurs droits. S’il est indéniable que les textes constitutionnels étatiques américains rédigés en 1776 ont un accent lockéen, notamment dans l’idée que toute autorité politique doit dériver du peuple, la distinction tranchée entre un « droit des Anglais » particulariste et un « droit naturel » universaliste, comme on la présente trop souvent, n’aurait eu aucun sens pour les révolutionnaires américains. Si ces derniers insistèrent sur l’égale liberté de tous les membres de l’État, s’ils firent de cette égalité un élément naturel devant être protégé par la mise sur pied de nouveaux espaces politiques de liberté, c’est qu’ils poursuivaient aussi une condamnation de l’Angleterre, amorcée plus d’une dizaine d’années auparavant, et qui avait pour objet la reconnaissance de l’égalité entre les sujets anglais et américains. En d’autres termes, pendant la crise impériale, la cohérence de tous les arguments pouvant justifier des inégalités politiques avait été testée et, en dernière analyse, répudiée par les Américains. La notion d’égalité de tous les êtres humains, présente dans le christianisme, sécularisée par les premiers penseurs de la modernité, incarnée par l’idée d’appartenance à un même corps politique dans l’imaginaire national anglais, trouve dans les constitutions étatiques américaines sa forme politique achevée.

