La Révolution française d'Albert Mathiez Annonces
samedi 13 octobre 2012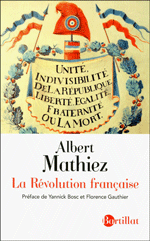
Albert Mathiez, La Révolution française, Paris, Bartillat, 2012, 658 p. Introduction de Yannick Bosc et Florence Gauthier.
Cette réédition rassemble en un seul volume les trois parties de l'ouvrage publiées entre 1922 et 1927 : La Chute de la royauté ; La Gironde et la Montagne ; La Terreur. Pour la première fois, La Révolution française est accompagnée d'un index, d'une chronologie et d'un appareil critique rappelant l'oeuvre et la vie d'Albert Mathiez.
Nous en proposons le premier chapitre consacré à "La crise de l'Ancien Régime".
Les révolutions, les véritables, celles qui ne se bornent pas à changer les formes politiques et le personnel gouvernemental, mais qui transforment les institutions et déplacent la propriété, cheminent longtemps invisibles avant d’éclater au grand jour sous l’effet de quelques circonstances fortuites. La Révolution française, qui surprit, par sa soudaineté irrésistible, ceux qui en furent les auteurs et les bénéficiaires comme ceux qui en furent les victimes, s’est préparée lentement pendant un siècle et plus. Elle sortit du divorce, chaque jour plus profond, entre les réalités et les lois, entre les institutions et les mœurs, entre la lettre et l’esprit.
Les producteurs, sur qui reposait la vie de la société, accroissaient chaque jour leur puissance, mais le travail restait une tare aux termes du code. On était noble dans la mesure où on était inutile. La naissance et l’oisiveté conféraient des privilèges qui devenaient de plus en plus insupportables à ceux qui créaient et détenaient les richesses.
En théorie le monarque, représentant de Dieu sur la terre, était absolu. Sa volonté était la loi. Lex Rex. En fait il ne pouvait plus se faire obéir même de ses fonctionnaires immédiats. Il agissait si mollement qu’il semblait douter lui-même de ses droits. Au-dessus de lui planait un pouvoir nouveau et anonyme, l’opinion, qui minait l’ordre établi dans le respect des hommes.
Le vieux système féodal reposait essentiellement sur la propriété foncière. Le seigneur confondait en sa personne les droits du propriétaire et les fonctions de l’administrateur, du juge et du chef militaire. Or, depuis longtemps déjà, le seigneur a perdu sur ses terres toutes les fonctions publiques qui sont passées aux agents du roi. Le servage a presque partout disparu. Il n’y a plus de mainmortables que dans quelques domaines ecclésiastiques, dans le Jura, le Nivernais, la Bourgogne. La glèbe, presque entièrement émancipée n’est plus rattachée au seigneur que par le lien assez lâche des rentes féodales, dont le maintien ne se justifie plus par les services rendus.
Les rentes féodales, sorte de fermages perpétuels perçus tantôt en nature (champart), tantôt en argent (cens), ne rapportent guère aux seigneurs qu’une centaine de millions par an, somme assez faible eu égard à la diminution constante du pouvoir de l’argent. Elles ont été fixées une fois pour toutes, il y a des siècles, au moment de la suppression du servage, à un taux invariable, tandis que le prix des choses a monté sans cesse. Les seigneurs, qui sont dépourvus d’emplois, tirent maintenant le plus clair de leurs ressources des propriétés qu’ils se sont réservées en propre et qu’ils exploitent directement ou par leurs intendants.
Le droit d’aînesse défend le patrimoine des héritiers du nom ; mais les cadets, qui ne réussissent pas à entrer dans l’Armée ou dans l’Église, sont réduits à des parts infimes qui ne suffisent bientôt plus à les faire vivre. A la première génération ils se partagent le tiers des biens paternels, à la deuxième, le tiers de ce tiers et ainsi de suite. Réduits à la gêne, ils vendent pour subsister leurs droits de justice, leurs cens, leurs champarts, leurs terres, mais ils ne songent pas à travailler, car ils ne veulent pas déroger. Une véritable plèbe nobiliaire s’est formée, très nombreuse en certaines provinces, comme la Bretagne, le Poitou, le Boulonnais, etc. Elle végète assombrie dans ses modestes manoirs. Elle déteste la haute noblesse en possession des emplois de Cour. Elle méprise et envie le bourgeois de la ville, qui s’enrichit par le commerce et l’industrie. Elle défend avec âpreté contre les empiétements des agents du roi ses dernières immunités fiscales. Elle se fait d’autant plus arrogante qu’elle est plus pauvre et plus impuissante.
Exclu de tout pouvoir politique et administratif depuis que l’absolutisme monarchique a pris définitivement racine avec Richelieu et Louis XIV, le hobereau est souvent haï de ses paysans parce qu’il est obligé pour vivre de se montrer exigeant sur le paiement de ses rentes. La basse justice, dernier débris qu’il a conservé de son antique puissance, devient entre les mains de ses juges mal payés un odieux instrument fiscal. Il s’en sert notamment pour s’emparer des communaux dont il revendique le tiers au nom du droit de triage. La chèvre du pauvre, privée des communaux, ne trouve plus sa pitance et les plaintes des petites gens s’aigrissent. La petite noblesse, malgré le partage des communaux, se juge sacrifiée. A la première occasion elle manifestera son mécontentement. Elle sera un élément de troubles.
En apparence la haute noblesse, surtout les 4 000 familles « présentées », qui paradent à la Cour, chassent avec le roi et montent dans ses carrosses, n’ont pas à se plaindre du sort. Elles se partagent les 33 millions que rapportent par an les charges de la maison du roi et des princes, les 28 millions des pensions qui s’alignent en colonnes serrées sur le livre rouge, les 46 millions de la solde des 12 000 officiers de l’armée qui absorberont à eux seuls plus de la moitié du budget militaire, tous les millions enfin de nombreuses sinécures telles que les charges de gouverneurs des provinces. Elles soutirent ainsi près du quart du budget. A ces nobles présentés reviennent encore les grosses abbayes que le roi distribue à leurs fils cadets souvent tonsurés à douze ans. Pas un seul des 143 évêques qui ne soit noble en 1789. Ces évêques gentilshommes vivent à la Cour loin de leurs diocèses, qu’ils ne connaissent guère que par les revenus qu’ils leur rapportent. Les biens du clergé produisent 120 millions par an environ et les dîmes, perçues sur la récolte des paysans, en produisent à peu près autant, soit 240 millions qui s’ajoutent aux autres dotations de la haute noblesse. Le menu fretin des curés, qui assure le service divin, ne recueille que les écailles. La « portion congrue » vient seulement d’être portée à 700 livres pour les curés et à 350 livres pour les vicaires. Mais de quoi se plaignent ces roturiers ?
La haute noblesse coûte donc très cher. Comme elle possède en propre de grands domaines, dont la valeur dépassera 4 milliards quand ils seront vendus sous la Terreur, elle dispose de ressources abondantes qui lui permettent, semble-t-il, de soutenir son état avec magnificence. Un courtisan est pauvre quand il n’a que 100 000 livres de rentes. Les Polignac touchent sur le Trésor en pensions et gratifications 500 000 livres d’abord, puis 700 000 livres par an. Mais l’homme de Cour passe son temps à « représenter ». La vie de Versailles est un gouffre où les plus grosses fortunes s’anéantissent. On joue un jeu d’enfer, à l’exemple de Marie-Antoinette. Les vêtements somptueux, brochés d’or et d’argent, les carrosses, les livrées, les chasses, les réceptions, les spectacles, les plaisirs exigent des sommes énormes. La haute noblesse s’endette et se ruine avec désinvolture. Elle s’en remet à des intendants qui la volent, du soin d’administrer ses revenus, dont elle ignore parfois l’état exact. Biron, duc de Lauzun, don Juan notoire, a mangé 100 000 écus à vingt et un ans et s’est endetté en outre de 2 millions. Le comte de Clermont, abbé de Saint-Germain-des-Prés, prince du sang, avec 360 000 livres de revenu a l’art de se ruiner à deux reprises. Le duc d’Orléans, qui est le plus grand propriétaire de France, s’endette de 74 millions. Le prince de Rohan-Guémenée fait une faillite d’une trentaine de millions dont Louis XVI contribue à payer la plus grande part. Les comtes de Provence et d’Artois, frères du roi, doivent, à vingt-cinq ans, une dizaine de millions. Les autres gens de Cour suivent le courant et les hypothèques s’abattent sur leurs terres. Les moins scrupuleux se livrent à l’agiotage pour se remettre à flot. Le comte de Guines, ambassadeur à Londres, est mêlé à une affaire d’escroquerie qui a son épilogue devant les tribunaux. Le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg, spécule sur la vente de l’enclos du Temple à Paris, bien d’Église qu’il aliène comme place à bâtir. Il y en a, comme le marquis de Sillery, mari de Mme de Genlis, qui font de leurs salons des salles de tripot. Tous fréquentent les gens de théâtre et se déclassent. Des évêques comme Dillon, de Narbonne, et Jarente, d’Orléans, vivent publiquement avec des concubines qui président à leurs réceptions.
Chose curieuse, ces nobles de Cour, qui doivent tout au roi, sont loin d’être dociles. Beaucoup s’ennuient de leur oisiveté dorée. Les meilleurs et les plus ambitieux rêvent d’une vie plus active. Ils voudraient, comme les lords d’Angleterre, jouer un rôle dans l’État, être autre chose que des figurants. Ils épousent les idées nouvelles en les ajustant à leurs désirs. Plusieurs et non des moindres, les La Fayette, les Custine, les deux Vioménil, les quatre Lameth, les trois Dillon, qui ont mis leur épée au service de la liberté américaine, font, à leur retour en France, figure d’opposants. Les autres sont partagés en factions qui intriguent et conspirent autour des princes du sang contre les favoris de la reine. A l’heure du péril, la haute noblesse ne sera pas unanime, tant s’en faut ! à défendre le trône.
L’ordre de la noblesse comprend en réalité des castes distinctes et rivales dont les plus puissantes ne sont pas celles qui peuvent invoquer les parchemins les plus anciens. A côté de la noblesse de race ou d’épée s’est constituée, au cours des deux derniers siècles, une noblesse de robe ou d’offices qui monopolise les emplois administratifs et judiciaires. Les membres des parlements, qui rendent la justice d’appel, sont à la tête de cette nouvelle caste aussi orgueilleuse et plus riche peut-être que l’ancienne. Maîtres de leurs charges qu’ils ont achetées très cher et qu’ils se transmettent de père en fils, les magistrats sont en fait inamovibles. L’exercice de la justice met dans leur dépendance le monde innombrable des plaideurs. Ils s’enrichissent par les épices et achètent de grandes propriétés. Les juges du parlement de Bordeaux possèdent les meilleurs crus du Bordelais. Ceux de Paris, dont les revenus égalent parfois ceux des grands seigneurs, souffrent de ne pouvoir être présentés à la Cour, faute de « quartiers » suffisants. Ils s’enferment dans une morgue hautaine de parvenus et prétendent diriger l’État. Comme tout acte royal, édit, ordonnance ou même traité diplomatique, ne peut entrer en vigueur qu’autant que son texte aura été couché sur leurs registres, les magistrats prennent prétexte de ce droit d’enregistrement pour jeter un coup d’œil sur l’administration royale et pour émettre des remontrances. Dans le pays muet, ils ont seuls le droit de critique et ils en usent pour se populariser en protestant contre les nouveaux impôts, en dénonçant le luxe de la Cour, les gaspillages, les abus de toute sorte. Ils s’enhardissent parfois à lancer des mandats de comparution contre les plus hauts fonctionnaires qu’ils soumettent à des enquêtes infamantes, comme ils firent pour le duc d’Aiguillon, commandant de Bretagne, comme ils feront pour le ministre Calonne, au lendemain de sa disgrâce. Sous prétexte que, dans le lointain des âges, la Cour de justice, le Parlement proprement dit, n’était qu’une section de l’assemblée générale des vassaux de la couronne que les rois étaient alors tenus de consulter avant tout nouvel impôt, sous prétexte aussi qu’à certaines audiences solennelles, ou lits de justice, les princes du sang, les ducs et pairs viennent prendre séance à côté d’eux, ils affirment qu’en l’absence des états généraux, ils représentent les vassaux et ils évoquent le droit féodal, l’ancienne constitution de la monarchie, pour mettre en échec le gouvernement et le roi. Leur résistance va jusqu’à la grève, jusqu’aux démissions en masse. Les différents parlements du royaume se coalisent. Ils prétendent qu’ils ne forment qu’un seul corps divisé en classes, et les autres cours souveraines, Cour des comptes, Cour des aides, appuient leurs menées factieuses. Louis XV, qui était un roi, malgré son indolence, finit par se lasser de leur perpétuelle opposition. Sur le conseil du chancelier Maupeou, il supprima le Parlement de Paris à la fin de son règne et le remplaça par des conseils supérieurs confinés dans les seules attributions judiciaires. Mais le faible Louis XVI, cédant aux exigences de ce qu’il croyait être l’opinion publique, rétablit le Parlement à son avènement et prépara ainsi la perte de sa couronne. Si les légers pamphlets des philosophes ont contribué à discréditer l’Ancien Régime, à coup sûr les massives remontrances des gens de justice ont fait plus encore pour répandre dans le peuple l’irrespect et la haine de l’ordre établi.
Le roi, qui voit se dresser contre lui les « officiers » qui rendent en son nom la justice, peut-il du moins compter sur l’obéissance et sur le dévouement des autres « officiers » qui forment ses conseils ou qui administrent pour lui les provinces ? Le temps n’est plus où les agents du roi étaient les ennemis-nés des anciens pouvoirs féodaux qu’ils avaient dépossédés. Les offices anoblissaient. Les roturiers de la veille sont devenus des privilégiés. Dès le temps de Louis XIV on donnait aux ministres du Monseigneur. Leurs fils étaient faits comtes ou marquis. Sous Louis XV et Louis XVI, les ministres furent choisis de plus en plus dans la noblesse et pas seulement dans la noblesse de robe, mais dans la vieille noblesse d’épée. Parmi les trente-six personnages qui occupèrent les portefeuilles de 1774 à 1789, il n’y en eut qu’un seul qui ne fût pas noble, le citoyen de Genève, Necker, qui voulut d’ailleurs que sa fille fût baronne. Contrairement à ce qu’on dit trop souvent, les intendants eux-mêmes, sur qui reposait l’administration des provinces, n’étaient plus choisis parmi les hommes de naissance commune. Tous ceux qui furent en fonction sous Louis XVI appartenaient à des familles nobles ou anoblies et parfois depuis plusieurs générations. Un de Trémond, intendant de Montauban, un Fournier de la Chapelle, intendant d’Auch, pouvaient remonter au XIIIe siècle. Il y avait des dynasties d’intendants comme il y avait des dynasties de parlementaires. Il est vrai que les intendants, ne tenant pas leur place par office, étaient révocables comme les maîtres des requêtes au conseil du roi parmi lesquels ils se recrutaient, mais leurs richesses, les offices judiciaires qu’ils cumulaient avec leurs fonctions administratives, leur assuraient une réelle indépendance. Beaucoup cherchaient à se populariser dans leur « généralité ». Ils n’étaient plus les instruments dociles qu’avaient été leurs prédécesseurs du grand siècle. Le roi était de plus en plus mal obéi. Les parlements n’auraient pas osé soutenir des luttes aussi prolongées contre les ministres si ceux-ci avaient pu compter sur le concours absolu de tous les administrateurs leurs subordonnés. Mais les différentes noblesses sentaient de plus en plus leur solidarité. Elles savaient à l’occasion oublier leurs rivalités pour faire front tout ensemble contre les peuples et contre le roi, quand celui-ci était par hasard touché par quelque velléité de réforme.
Les pays d’états, c’est-à-dire les provinces, tardivement rattachées au royaume, qui avaient conservé un simulacre de représentation féodale, manifestent sous Louis XVI des tendances particularistes. La résistance des états de Provence, en 1782, forçait le roi à retirer un droit d’octroi sur les huiles. Les états du Béarn et de Foix, en 1786, refusaient de voter un nouvel impôt. Les états de Bretagne, coalisés avec le parlement de Rennes, parvenaient à mettre en échec l’intendant, dès le temps de Louis XV, à propos de la corvée. Ils s’emparaient même de la direction des travaux publics. Ainsi, la centralisation administrative reculait.
Partout la confusion et le chaos. Au centre, deux organes distincts : le Conseil, divisé en nombreuses sections, et les six ministres, indépendants les uns des autres, simples commis qui ne délibèrent pas en commun et qui n’ont pas tous entrée au Conseil. Les divers services publics chevauchent d’un département à l’autre, selon les convenances personnelles. Le contrôleur général des finances avoue qu’il lui est impossible de dresser un budget régulier, à cause de l’enchevêtrement des exercices, de la multiplicité des diverses caisses, de l’absence d’une comptabilité régulière. Chacun tire de son côté. Sartine, ministre de la Marine, dépense des millions à l’insu du contrôleur général. Aucun ensemble dans les mesures prises. Tel ministre protège les philosophes, tel autre les persécute. Tous se jalousent et intriguent. Leur grande préoccupation est moins d’administrer que de retenir la faveur du maître ou de ses entours. L’intérêt public n’est plus défendu. L’absolutisme de droit divin sert à couvrir toutes les dilapidations, tous les arbitraires, tous les abus. Aussi les ministres et les intendants sont-ils communément détestés, et la centralisation imparfaite qu’ils personnifient, loin de fortifier la monarchie, tourne contre elle l’opinion publique.
Les circonscriptions administratives reflètent la formation historique du royaume. Elles ne sont plus en rapport avec les nécessités de la vie moderne. Les frontières, même du côté de l’étranger, sont indécises. On ne sait pas au juste où finit l’autorité du roi et où elle commence. Des villes et villages sont mi-partie France et Empire. La commune de Rarécourt, près Vitry-le-François, en pleine Champagne, paie trois fois 2 sous 6 deniers par tête de chef de famille à ses trois suzerains : le roi de France, l’empereur d’Allemagne et le prince de Condé. La Provence, le Dauphiné, le Béarn, la Bretagne, l’Alsace, la Franche-Comté, etc., invoquent les vieilles « capitulations » qui les ont réunies à la France et considèrent volontiers que le roi n’est chez elles que seigneur, comte ou duc. Le maire de la commune de Morlaas en Béarn formule, au début du cahier de doléances de 1789, la question suivante : « Jusqu’à quel point nous convient-il de cesser d’être Béarnais pour devenir plus ou moins Français ? » La Navarre continue d’être un royaume distinct qui refuse d’être représenté aux états généraux. Selon le mot de Mirabeau, la France n’est toujours qu’un « agrégat inconstitué de peuples désunis ».
Les vieilles divisions judiciaires, bailliages dans le Nord et sénéchaussées dans le Midi, sont restées superposées aux anciens fiefs féodaux dans une bigarrure étonnante. Les bureaux de Versailles ne savent pas au juste le nombre des sièges de justice et, à plus forte raison, l’étendue de leur ressort. Ils commettront, en 1789, d’étranges erreurs dans l’expédition des lettres de convocation aux états généraux. Les circonscriptions militaires ou gouvernements qui datent du XVIe siècle n’ont pour ainsi dire pas varié ; les circonscriptions financières administrées par les intendants, ou généralités, qui datent du siècle suivant, n’ont pas été davantage ajustées aux besoins nouveaux. Les circonscriptions ecclésiastiques ou provinces sont restées presque immuables depuis l’Empire romain. Elles chevauchent de part et d’autre de la frontière politique. Des curés français relèvent de prélats allemands et réciproquement.
Quand l’ordre social sera ébranlé, la vieille machine administrative, composite, rouillée et grinçante, sera incapable de fournir un effort sérieux de résistance.
En face des privilégiés et des « officiers » en possession de l’État se lèvent peu à peu les forces nouvelles nées du négoce et de l’industrie. D’un côté la propriété féodale et foncière, de l’autre la richesse mobilière et bourgeoise.
Malgré les entraves du régime corporatif, moins oppressif cependant qu’on ne l’a cru, malgré les douanes intérieures et les péages, malgré la diversité des mesures de poids, de longueur et de capacité, le commerce et l’industrie ont grandi pendant tout le siècle. Pour la valeur des échanges la France vient immédiatement après l’Angleterre. Elle a le monopole des denrées coloniales. Sa possession de Saint-Domingue fournit à elle seule la moitié du sucre consommé dans le monde. L’industrie de la soie, qui fait vivre à Lyon 65 000 ouvriers, n’a pas de rivale. Nos eaux-de-vie, nos vins, nos étoffes, nos modes, nos meubles se vendent dans toute l’Europe. La métallurgie elle-même, dont le développement a été tardif, progresse. Le Creusot, qu’on appelle encore Montcenis, est déjà une usine modèle pourvue du dernier perfectionnement, et Dietrich, le roi du fer de l’époque, emploie dans ses hauts fourneaux et ses forges de Basse-Alsace, outillés à l’anglaise, des centaines d’ouvriers. Un armateur de Bordeaux, Bonaffé, possède, en 1791, une flotte de trente navires et une fortune de 16 millions. Ce millionnaire n’est pas une exception, tant s’en faut. Il y a à Lyon, à Marseille, à Nantes, au Havre, à Rouen, de très grosses fortunes.
L’essor économique est si intense que les banques se multiplient sous Louis XVI. La Caisse d’escompte de Paris émet déjà des billets analogues à ceux de notre Banque de France. Les capitaux commencent à se grouper en sociétés par actions : Compagnie des Indes, Compagnies d’assurances sur l’incendie, sur la vie, Compagnie des eaux de Paris. L’usine métallurgique de Montcenis est montée par actions. Les titres cotés en Bourse à côté des rentes sur l’Hôtel de Ville (c’est-à-dire sur l’État) donnent lieu à des spéculations très actives. On pratique déjà le marché à terme.
Le service de la dette publique absorbe, en 1789, 300 millions par an, c’est-à-dire plus de la moitié de toutes les recettes de l’État. La Compagnie des fermiers généraux, qui perçoit pour le compte du roi le produit des impôts indirects, aides, gabelle, tabac, timbre, etc., compte à sa tête des financiers de premier ordre qui rivalisent de magnificence avec les nobles les plus huppés. Il circule à travers la bourgeoisie un énorme courant d’affaires. Les charges d’agents de change doublaient de prix en une année. Necker a écrit que la France possédait près de la moitié du numéraire existant en Europe. Les négociants achètent les terres des nobles endettés. Ils se font bâtir d’élégants hôtels que décorent les meilleurs artistes. Les fermiers généraux ont leurs « folies » dans les faubourgs de Paris, comme les grands seigneurs. Les villes se transforment et s’embellissent.
Un signe infaillible que le pays s’enrichit, c’est que la population augmente rapidement et que le prix des denrées, des terres et des maisons subit une hausse constante. La France renferme déjà vingt-cinq millions d’habitants, deux fois autant que l’Angleterre ou que la Prusse. Le bien-être descend peu à peu de la haute bourgeoisie dans la moyenne et dans la petite. On s’habille mieux, on se nourrit mieux qu’autrefois. Surtout on s’instruit. Les filles de la roture, qu’on appelle maintenant demoiselles pourvu qu’elles portent des paniers, achètent des pianos. La plus-value des impôts de consommation atteste les progrès de l’aisance.
Ce n’est pas dans un pays épuisé, mais au contraire dans un pays florissant, en plein essor, qu’éclatera la Révolution. La misère, qui détermine parfois des émeutes, ne peut pas provoquer les grands bouleversements sociaux. Ceux-ci naissent toujours du déséquilibre des classes.
La bourgeoisie possédait certainement la majeure partie de la fortune française. Elle progressait sans cesse, tandis que les ordres privilégiés se ruinaient. Sa croissance même lui faisait sentir plus vivement les infériorités légales auxquelles elle restait condamnée. Barnave devint révolutionnaire le jour où un noble expulsa sa mère de la loge qu’elle occupait au théâtre de Grenoble. Mme Roland se plaint qu’ayant été retenue avec sa mère à dîner au château de Fontenay, on les servit à l’office. Blessures de l’amour-propre, combien avez-vous fait d’ennemis à l’Ancien Régime ?
La bourgeoisie, qui tient l’argent, s’est emparée aussi du pouvoir moral. Les hommes de lettres, sortis de ses rangs, se sont affranchis peu à peu de la domesticité nobiliaire. Ils écrivent maintenant pour le grand public qui les lit, ils flattent ses goûts, ils défendent ses revendications. Leur plume ironique persifle sans cesse toutes les idées sur lesquelles repose l’édifice ancien et tout d’abord l’idée religieuse. La tâche leur est singulièrement facilitée par les querelles théologiques qui déconsidèrent les hommes de la tradition. Entre le jansénisme et l’ultramontanisme, la philosophie fait sa trouée. La suppression des jésuites, en 1763, jette à bas le dernier rempart un peu sérieux qui s’opposait à l’esprit nouveau. La vie religieuse n’a plus d’attraits. Les couvents se dépeuplent, les donations pieuses tombent à des chiffres infimes. Dès lors les novateurs ont cause gagnée. Le haut clergé se défend à peine. Les prélats de Cour se croiraient déshonorés s’ils passaient pour dévots. Ils mettent leur coquetterie à répandre les lumières. Ils ne veulent plus être dans leurs diocèses que des auxiliaires de l’administration. Leur zèle n’est plus au service du bonheur céleste, mais du bonheur terrestre. Un idéal utilitaire s’impose uniformément à tous ceux qui parlent ou qui écrivent. La foi traditionnelle est reléguée à l’usage du peuple comme un complément obligé de l’ignorance et de la roture. Les curés eux-mêmes lisent l’Encyclopédie et s’imprègnent de Mably, de Raynal et de Jean-Jacques.
Aucun de ces grands seigneurs, qui applaudissent les hardiesses et les impertinences des philosophes, ne prend garde que l’idée religieuse est la clef de voûte du régime. Comment la libre critique, une fois déchaînée, se contenterait-elle de bafouer la superstition ? Elle s’attaque aux institutions les plus vénérables. Elle propage partout le doute et l’ironie. Les privilégiés pourtant ne semblent pas comprendre. Le comte de Vaudreuil, tendre ami de la Polignac, fait jouer dans son château de Gennevilliers Le Mariage de Figaro, c’est-à-dire la satire la plus cinglante et la plus audacieuse de la caste nobiliaire. Marie-Antoinette s’entremet pour que la pièce, jusque-là interdite, puisse être jouée au Théâtre-Français. La révolution était faite dans les esprits longtemps avant de se traduire dans les faits, et parmi ses auteurs responsables il faut compter à bon droit ceux-là mêmes qui seront ses premières victimes.
La révolution ne pouvait venir que d’en haut. Le peuple des travailleurs, dont l’étroit horizon ne dépassait pas la profession, était incapable d’en prendre l’initiative et, à plus forte raison, d’en saisir la direction. La grande industrie commençait à peine. Les ouvriers ne formaient nulle part des groupements cohérents. Ceux qu’enrôlaient et subordonnaient les corporations étaient divisés en compagnonnages rivaux plus préoccupés à se quereller pour des raisons mesquines qu’à faire front contre le patronat. Ils avaient d’ailleurs l’espoir et la possibilité de devenir patrons à leur tour, puisque la petite artisanerie était toujours la forme normale de la production industrielle. Quant aux autres, à ceux qui commençaient à être employés dans les « manufactures », beaucoup étaient des paysans qui ne considéraient leur salaire industriel que comme un appoint à leurs ressources agricoles. La plupart se montrèrent dociles et respectueux à l’égard des employeurs qui leur procuraient du travail, à tel point qu’ils les considéraient, en 1789, comme leurs représentants naturels. Les ouvriers se plaignent sans doute de la modicité des salaires qui n’ont pas grandi aussi vite que le prix des denrées, au dire de l’inspecteur aux manufactures Roland. Ils s’agitent parfois, mais ils n’ont pas encore le sentiment qu’ils forment une classe distincte du tiers état.
Les paysans sont les bêtes de somme de cette société. Dîmes, cens, champarts, corvées, impôts royaux, milice, toutes les charges s’abattent sur eux. Les pigeons et le gibier du seigneur ravagent impunément leurs récoltes. Ils habitent dans des maisons de terre battue, souvent couvertes de chaume, parfois sans cheminée. Ils ne connaissent la viande que les jours de fête et le sucre qu’en cas de maladie. Comparés à nos paysans d’aujourd’hui ils sont très misérables et cependant ils sont moins malheureux que ne l’ont été leurs pères ou que ne le sont leurs frères, les paysans d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne, d’Irlande ou de Pologne. A force de travail et d’économie certains ont pu acheter un morceau de champ ou de pré. La hausse des denrées agricoles a favorisé leur commencement de libération. Les plus à plaindre sont ceux qui n’ont pas réussi à acquérir un peu de terre. Ceux-là s’irritent contre le partage des communaux par les seigneurs, contre la suppression de la vaine pâture et du glanage qui leur enlève le peu de ressources qu’ils tiraient du communisme primitif. Nombreux aussi sont les journaliers qui subissent de fréquents chômages et qui sont obligés de se déplacer de ferme en ferme à la recherche de l’embauche. Entre eux et le peuple des vagabonds et des mendiants la limite est difficile à tracer. C’est là que se recrute l’armée des contrebandiers et des faux-sauniers en lutte perpétuelle contre les gabelous.
Ouvriers et paysans, capables d’un bref sursaut de révolte quand le joug devient trop pesant, ne discernent pas les moyens de changer l’ordre social. Ils commencent seulement à apprendre à lire. Mais à côté d’eux, il y a, pour les éclairer, le curé et le praticien, le curé auquel ils confient leurs chagrins, le praticien qui défend en justice leurs intérêts. Or le curé, qui a lu les écrits du siècle, qui connaît l’existence scandaleuse que mènent ses chefs dans leurs somptueux palais et qui vit péniblement de sa congrue, au lieu de prêcher à ses ouailles la résignation comme autrefois, fait passer dans leurs âmes un peu de l’indignation et de l’amertume dont la sienne est pleine. Le praticien, de son côté, qui est obligé, par nécessité professionnelle, de dépouiller les vieux grimoires féodaux, ne peut manquer d’estimer à leur valeur les titres archaïques sur lesquels sont fondées la richesse et l’oppression. Babeuf apprend à mépriser la propriété en pratiquant son métier de feudiste. Il plaint les paysans à qui l’avidité du seigneur, qui l’emploie à restaurer son chartrier, va extorquer de nouvelles rentes oubliées.
Ainsi se fait un sourd travail de critique qui de loin devance et prépare l’explosion. Que vienne l’occasion et toutes les colères accumulées et rentrées armeront les bras des misérables excités et guidés par la foule des mécontents.

