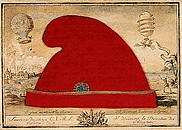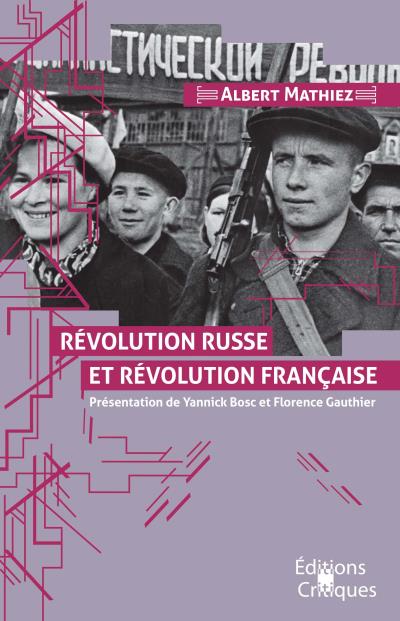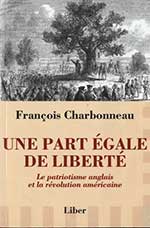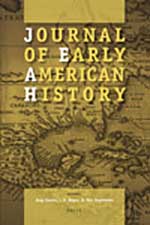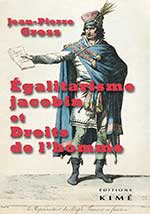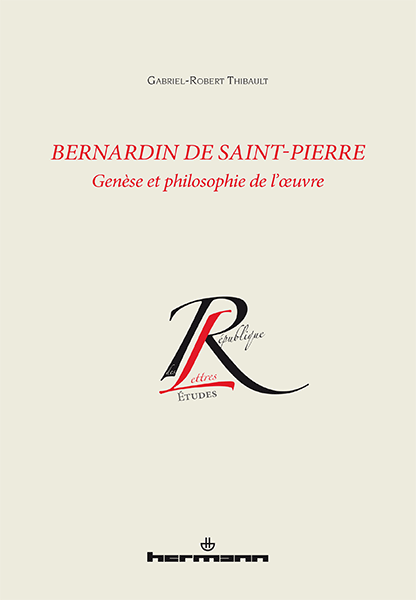Albert Mathiez, Robespierre et la république sociale Annonces
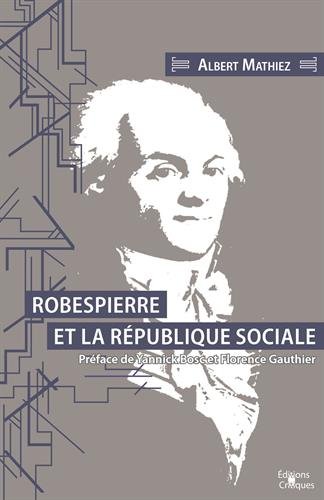
Albert Mathiez, Robespierre et la république sociale, Paris, Éditions Critiques, 2018, 368 p., introduction de Yannick Bosc et Florence Gauthier. L'ouvrage regroupe les principaux textes que Mathiez a consacrés à Robespierre. Nous proposons ici l'un d'entre eux, intitulé "Robespierre", une conférence organisée par le Groupe Fraternel du XIIIe et par la 7e Commission de l'USTICA (Union syndicale des techniciens de l'industrie, du commerce et de l'agriculture), publiée en 1924 par les éditions de la Maison des Jeunes.
Citoyens,
Aucun homme d’État de la Révolution n’a été plus populaire pendant sa vie que celui que les contemporains surnommèrent dès la Constituante du beau nom d’Incorruptible, aucun pourtant n’a été plus tristement calomnié après sa mort ni plus bassement outragé. On imprime couramment, jusque dans les livres scolaires qui servent à l’éducation des enfants de l’école laïque, qu’il fut un pieux calomniateur, un mystique assassin, un hypocrite sanguinaire, un ambitieux sans scrupules, on lui dénie jusqu’au talent, jusqu’à l’éloquence. On en fait un cerveau médiocre, une âme rétrécie. Quand ces gentillesses s’étalent sous la plume d’académiciens, d’écrivains bien-pensants, de remparts de l’ordre établi, cela s’explique, et il est naturel que Robespierre, qui a incarné la démocratie la plus hardie et qui l’a faite triompher tant qu’il a vécu, soit toujours poursuivi par la haine des ennemis de la justice et du progrès.