Négociateurs et consuls en Méditerranée à la fin du XVIIIe siècle Recensions
Par Marc Belissa, Université Paris X-Nanterre
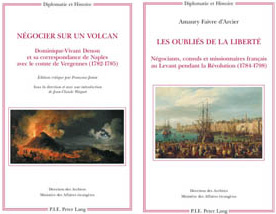
Deux ouvrages très différents — parus dans la collection Diplomatie et Histoire du Ministère des Affaires étrangères — viennent d’enrichir la bibliographie consacrée à la construction et au fonctionnement des réseaux diplomatiques à la fin du XVIIIe siècle et pendant la Révolution française. Il s"agit d’une part de Négocier sur un volcan. Dominique-Vivant Denon et sa correspondance de Naples avec le comte de Vergennes (1782-1785) et d’autre part Les oubliés de la Liberté. Négociants, consuls et missionnaires français au Levant pendant la Révolution (1784-1798). Le premier livre est l’édition critique intégrale de la correspondance diplomatique de Vivant Denon avec Vergennes lors de sa mission dans le royaume de Naples et des Deux Siciles à la veille de la Révolution. Établie par Françoise Janin, cette édition est dotée d’une copieuse introduction de Jean-Claude Waquet de l’École Pratique des Hautes Études. Le deuxième ouvrage est l’œuvre d’Amaury Faivre d’Arcier, lui-même consul adjoint, docteur en Histoire, helléniste et arabisant. Il s’agit pour ce dernier ouvrage d’un livre de facture très classique décrivant le monde des consuls et des marchands français dans l’Empire ottoman de 1784 à 1798.
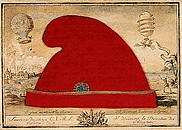
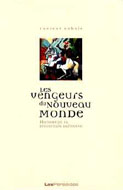
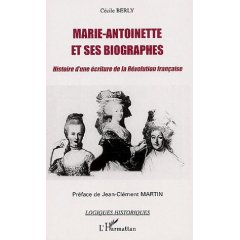
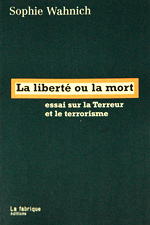
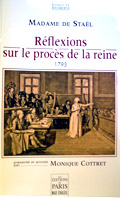 Madame de Staël, Réflexions sur le procès de la reine par une femme (1793), présenté et annoté par Monique Cottret, Les Editions de Paris, 2006, 126 pages.
Madame de Staël, Réflexions sur le procès de la reine par une femme (1793), présenté et annoté par Monique Cottret, Les Editions de Paris, 2006, 126 pages. Tirée de sa thèse de doctorat Entre esclavage et liberté : esclaves, libres et citoyens de couleur en Guadeloupe, une population en Révolution (1789-1802), l’ouvrage de Frédéric Régent porte sur l’histoire de l’archipel guadeloupéen entre le déclenchement de la Révolution française, qui entraîna un processus révolutionnaire dans les colonies des Amériques, et la politique de reprise en main et de rétablissement de l’esclavage conclue sous Bonaparte. Presque totalement ignoré en France – y compris par un certain nombre de ceux qui sont chargés d’enseigner l’Histoire - le cycle révolutionnaire qui couvre les années 1789 à 1802 se situe, depuis les revendications indépendantistes des décennies 1960-1980 puis les commémorations historiques successives programmées entre 1989 et 2004 (1), au centre de la mémoire populaire guadeloupéenne. En s’intéressant à cette période de l’histoire de la colonie, le livre de Frédéric Régent prend donc place dans ce double contexte totalement opposé sur chacune des rives de la mer océane. C’est à la mesure de ce contexte que se révèle ainsi le double positionnement adopté ici par l’historien : la volonté affirmée de révéler un passé inconnu ou méconnu de ses contemporains, accolée à la silencieuse ambition de remplacer les mythes d’une mémoire brûlante par la froide connaissance scientifique.
Tirée de sa thèse de doctorat Entre esclavage et liberté : esclaves, libres et citoyens de couleur en Guadeloupe, une population en Révolution (1789-1802), l’ouvrage de Frédéric Régent porte sur l’histoire de l’archipel guadeloupéen entre le déclenchement de la Révolution française, qui entraîna un processus révolutionnaire dans les colonies des Amériques, et la politique de reprise en main et de rétablissement de l’esclavage conclue sous Bonaparte. Presque totalement ignoré en France – y compris par un certain nombre de ceux qui sont chargés d’enseigner l’Histoire - le cycle révolutionnaire qui couvre les années 1789 à 1802 se situe, depuis les revendications indépendantistes des décennies 1960-1980 puis les commémorations historiques successives programmées entre 1989 et 2004 (1), au centre de la mémoire populaire guadeloupéenne. En s’intéressant à cette période de l’histoire de la colonie, le livre de Frédéric Régent prend donc place dans ce double contexte totalement opposé sur chacune des rives de la mer océane. C’est à la mesure de ce contexte que se révèle ainsi le double positionnement adopté ici par l’historien : la volonté affirmée de révéler un passé inconnu ou méconnu de ses contemporains, accolée à la silencieuse ambition de remplacer les mythes d’une mémoire brûlante par la froide connaissance scientifique.